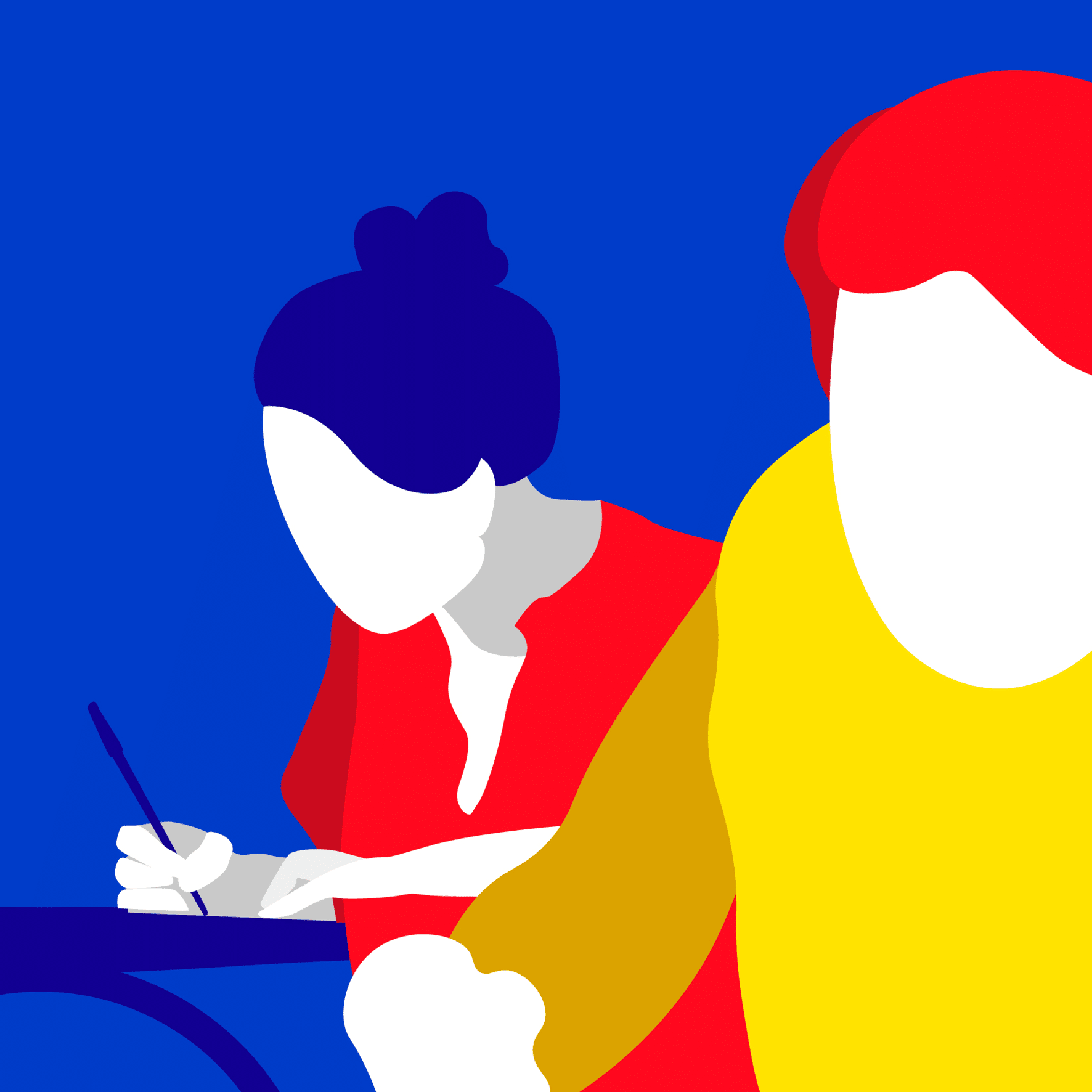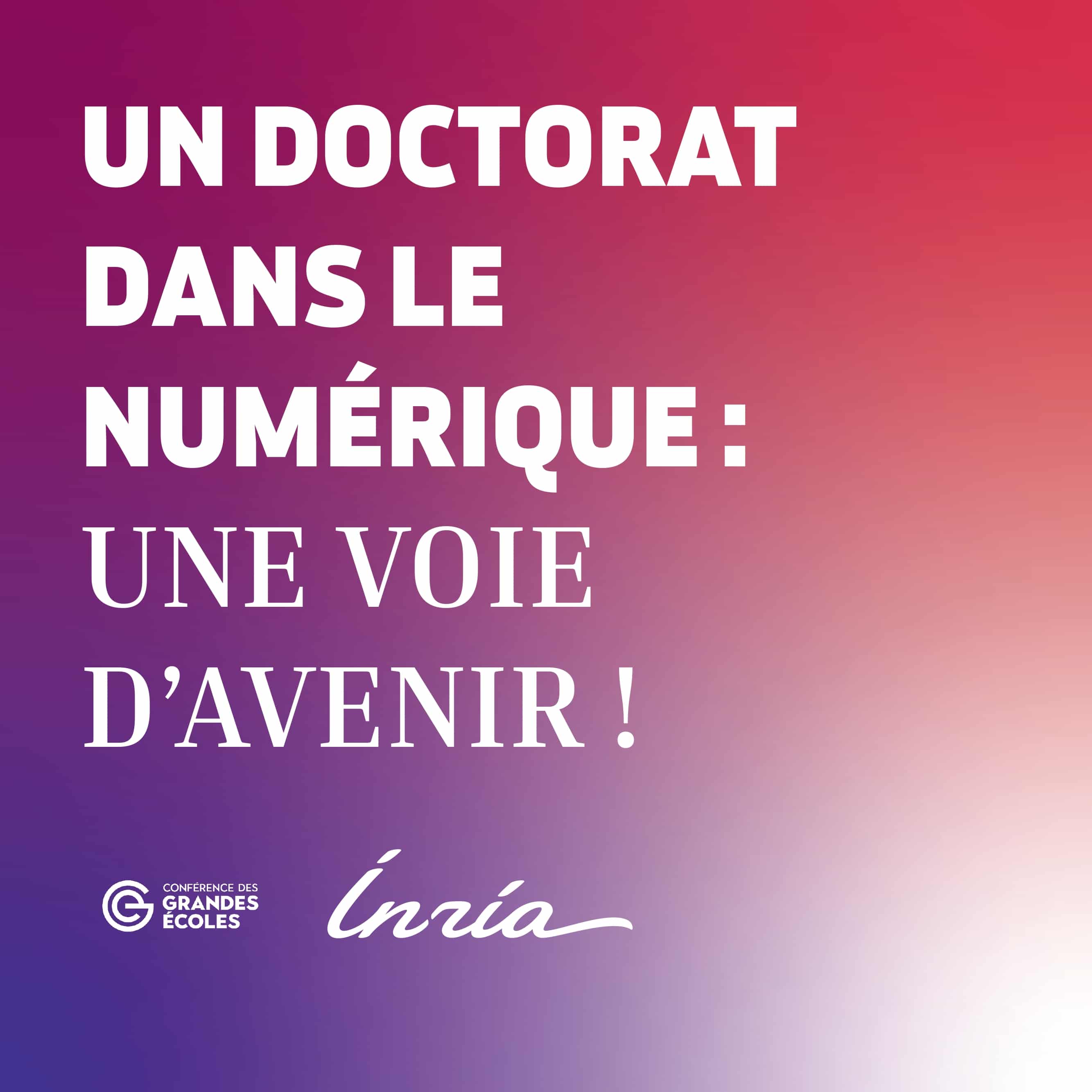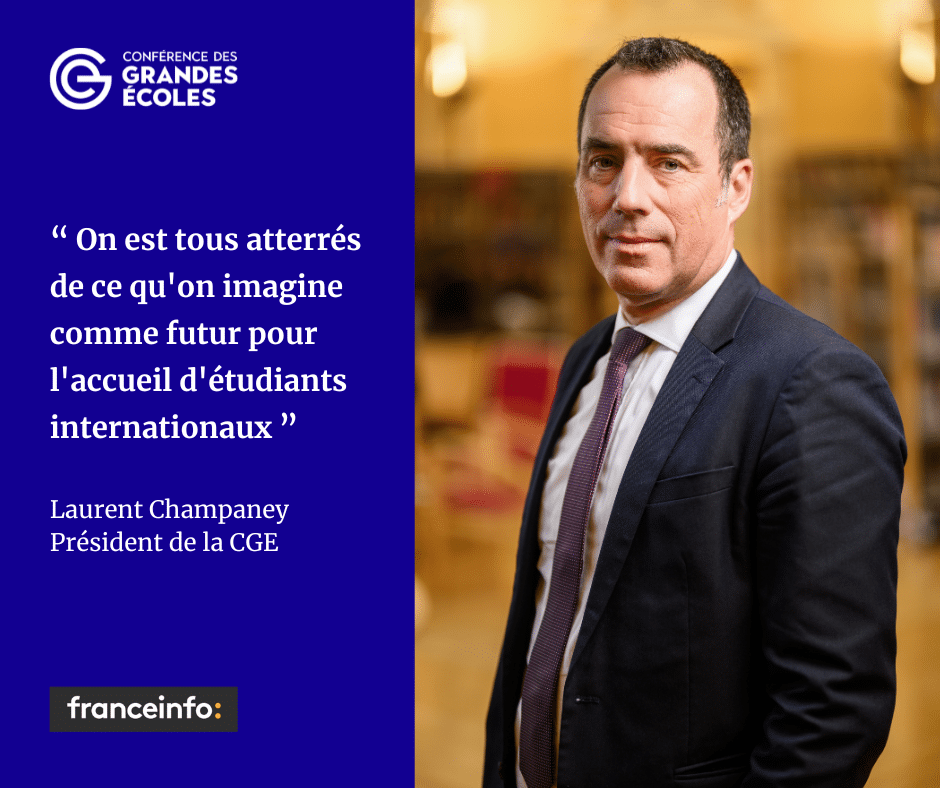Selon l’enquête TNS Sofres pour la CGE paru en mars 2016, de par la qualité des formations, l’accompagnement des étudiants, la reconnaissance à l’international ou sa modernité, la modèle Grande école est plébiscité par les Français. Pourtant cette reconnaissance ne saurait occulter le fait que pour un français sur deux, ce qui différencie avant tout une Grande école d’une université est le coût des études.
Si l’on considère en plus que 50% des jeunes (16-20 ans) estime que le niveau intellectuel requis pour accéder à une Grande école est inaccessible, ce sont la moitié des jeunes qui ne vont a priori pas tenter leur chance pour intégrer une Grande école. Ce constat est encore plus accablant quand l’on considère les Classes Préparatoires aux grandes Ecoles (CPGE), parmi les 30% de parents qui ne souhaitent pas que leur enfant intègre une CPGE, plus de la moitié soulèvent le coût comme principale raison.
Pourtant, malgré cette vision onéreuse des Grandes écoles, les parents sont 72% à souhaiter que leurs enfants intègrent une Grande école, et les trois quarts des Français estiment qu’il s’agit là d’un investissement rentable à long terme.
Une conclusion s’impose : cette image tronquée du coût des études ainsi qu’une méconnaissance de la diversité des Grandes écoles conduit une partie des Français à écarter par principe cette voie de formation pour eux-mêmes ou leurs enfants. Il s’agit là d’un défi majeur pour les Grandes écoles et l’enseignement supérieur qui doivent au contraire aller chercher tous les talents où qu’ils soient. Aucun jeune en France ne devrait écarter la possibilité de faire des études supérieures ambitieuses parce qu’il ou elle pense ne pas en avoir les moyens.
Si l’on se place du point de vue d’un jeune qui choisit ses études post-bac, les principaux critères sur le coût des études vont être les frais d’inscription et la vie étudiante (logement etc…). Ce qui résonne comme des évidences pour un public averti ne l’est plus nécessairement pour un jeune faisant face à la multitude d’options qui s’offrent à lui dans ce moment anxiogène où il doit décider de son avenir1 . Qui sait que les boursiers sont exemptés de frais d’inscription pour les concours ? Qui connait la multitude de bourses et d’aides aux étudiants versées par les régions et les collectivités territoriales, notamment pour les séjours à l’étranger ou les stages ? Qui sait que près des deux tiers des Grandes écoles sont publiques, avec des frais d’inscription fixés par les ministères à des niveaux raisonnables pour les étudiants ? Qui sait que plus de 80% des CPGE sont publiques et ne coûtent pas plus cher que l’université ?
Bref, quel jeune au moment de décider de son orientation est capable d’évaluer combien vont réellement couter ses études? Et comment faire un choix éclairé et ambitieux sans une information claire et non-biaisée ?
Des efforts de transparence et de pédagogie sont indubitablement à faire du côté des établissements eux-mêmes ou de leurs tutelles. Mais cette transparence ne devrait-elle pas fonctionner dans les deux sens ? Un étudiant dans un établissement public ne devrait-il pas savoir exactement combien l’Etat français investi dans sa formation grâce aux impôts des citoyens par rapport à ce qu’il paye comme frais d’inscription?
En 2011, un étudiant coûtait en moyenne 13 873 euros par an en France, contre 10 032 euros pour un élève de secondaire et 6 364 euros pour un élève de primaire. Ainsi, la dépense totale pour un parcours moyen d’étude est de 55 280 euros et 80 % de ce financement est d’origine publique, soit plus que dans la moyenne des pays de l’OCDE (70 %)2 .
En pourcentage du PIB, la Suède consacre en cumulant tous types de financement 1,7 % du PIB à l’enseignement supérieur, la Grande Bretagne 1,8 %, les Etats-Unis 2,8 % et la France seulement 1,4 %3 .
Face à la hausse attendue des besoins d’investissement dans l’enseignement supérieur (la Stratégie nationale pour l’Enseignement Supérieur fixe l’objectif de 60% d’une classe d’âge diplômée du supérieur contre 42% aujourd’hui), et dans un contexte de raréfaction des finances publiques, les leviers qui peuvent permettre d’augmenter les ressources propres des établissements d’enseignement supérieur tout en permettant la démocratisation exigeante du secteur doivent tous être actionnés. De nouvelles pistes émergent, comme la Formation Tout au Long de la Vie, l’introduction large du numérique qui invitent à réinventer complètement le modèle de financement actuel.
Les entreprises, premiers bénéficiaires des talents qui sortent des Grandes écoles doivent y prendre leur part (taxe d’apprentissage, chaires, mécénat…).
Les établissements eux-mêmes doivent apprendre à mieux mobiliser les fonds via leurs alumni, les fondations, ou aller chercher les fonds mis à dispositions par l’Europe pour financer les activités de recherche. Enfin, et surtout, l’Etat et les collectivités locales doivent également allouer un niveau d’investissement reflétant l’importance stratégique de ce secteur pour l’avenir du pays et de sa jeunesse Le niveau d’investissement public doit apporter la visibilité et la sécurité financière dont l’enseignement supérieur français a besoin dès aujourd’hui pour préparer son avenir, sous peine de devenir une destination de second choix sur le marché mondial de l’éducation supérieure.
Dans un contexte de mondialisation de l’enseignement supérieur et avec l’émergence d’une compétition internationale pour les meilleurs étudiants ou professeurs, qui sont de plus en plus mobiles, l’enseignement supérieur français est un vecteur de rayonnement et d’excellence pour le pays qui doit être préservé et développé5 . Les effectifs de l’enseignement supérieur dans le monde ont doublés entre 2000 et 2012 à près de 200 millions d’étudiants, un nombre qui devrait croître à 265 millions en 2025. Dans le même temps, l’Organisation Internationale de la Francophonie estime qu’il y aura 750 millions de francophones dans le monde en 2050 contre 220 millions en 2012.
A l’avenir, le financement de l’enseignement supérieur doit être à la fois soutenable à long terme et permettre d’offrir l’accès au savoir le plus large possible tout en développant des formations d’excellence adaptées aux futurs besoins de l‘économie et de la société française. Les frais d’inscriptions des étudiants ne représentent qu’une ressource parmi d’autres pour les établissements.
Il revient à tous d’imaginer ce nouveau modèle où chaque acteur financera équitablement un système d’enseignement supérieur de masse et de qualité, et où aucun jeune ne se refusera à tenter des études supérieures pour une question de coût.
La Conférence des grandes écoles
178% des français estiment que l’orientation post-bac est un moment « difficile » » et 66% d’entre eux s’estiment « mal informés ». Enquête TNS Sofres « Les Français et les Grandes écoles » Mars 2016.
2Note d’information Février 2016 DEPP http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/67/5/depp-ni-2016-05-depense-parcours-eleve-ou-etudiant-France-OCDE-2012_539675.pdf
3Source Regard sur l’éducation OCDE 2012
4Rapport STRANES septembre 2015 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid92442/pour-une-societe-apprenante-propositions-pour-une-strategie-nationale-de-l-enseignement-superieur.html
5La France est le 3ème pays au monde attirant le plus d’étudiants étrangers avec 271 399 étudiants étrangers en 2012 (Source UNESCO, Statistiques de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, juin 2014)