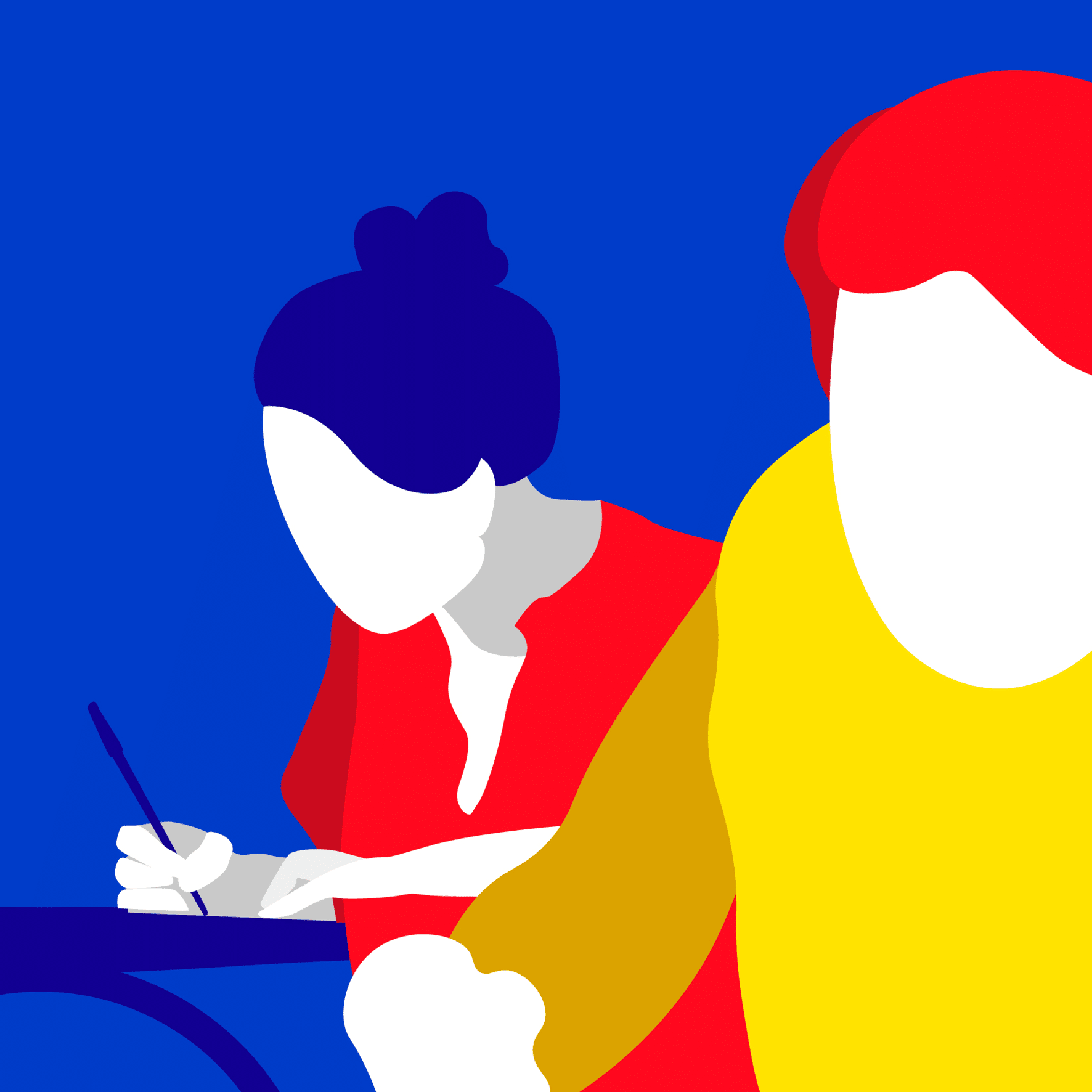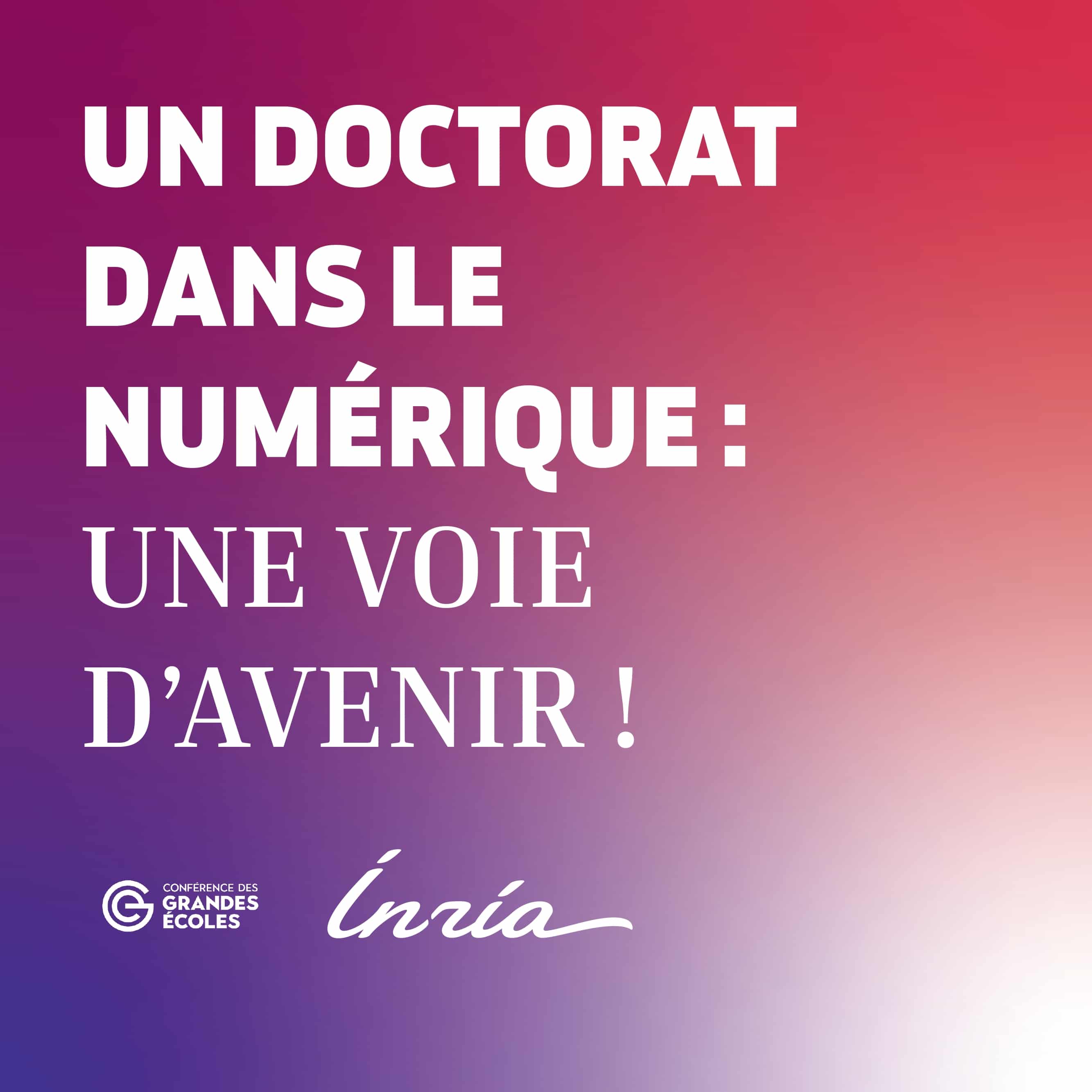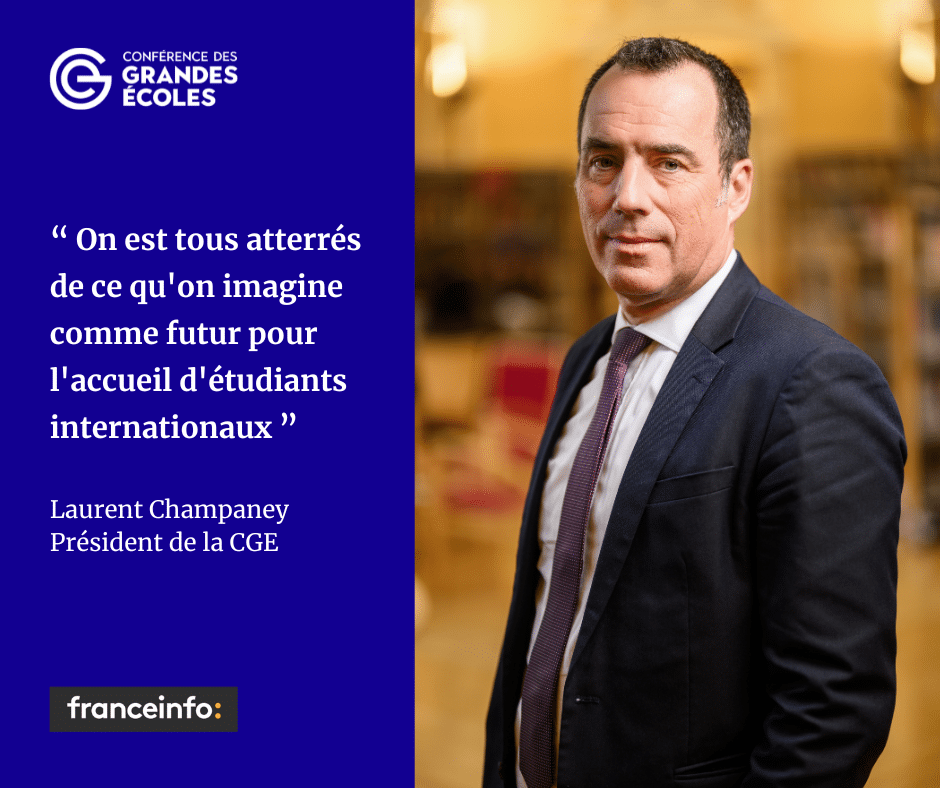Entamée à la rentrée 2010, la réforme du Lycée a présenté ses premiers bacheliers en 2013, nous en sommes donc cette année à la deuxième session. Les Grandes écoles et les universités sont en mesure d’en apprécier les effets pour le moins contrastés. Elles n’ont pas manqué d’en faire part en appui des travaux menés par la Conférence des grandes écoles et, dans une certaine mesure, par la Conférence des Présidents d’Université. C’est pourquoi sans attendre, il faut que soit posé un premier bilan d’une réforme dont il convient de rappeler la matrice initiale :
– favoriser une orientation progressive, plus tardive et moins définitive dans l’enseignement secondaire,
– accompagner par des moyens horaires et humains conséquents les élèves, afin d’améliorer leur réussite scolaire, avec comme perspective un accès pour la moitié d’une classe d’âge au niveau Licence et une réduction drastique du nombre de jeunes (actuellement 140 000) quittant le système éducatif sans diplôme ni qualification reconnus,
– développer les pratiques pédagogiques fondées sur les technologies numériques, notamment dans le domaine concerné par l’enseignement des langues vivantes dont on sait qu’il fait l’objet d’un étalonnage dans le cadre européen,
– donner de nouvelles marges d’autonomie pédagogiques et éducatives aux lycées, afin que soient mieux prises en considération la situation scolaire et sociale de leurs élèves.
Peu de voix se sont élevés contre ces principes généreux, car ils répondent très précisément à des critères de justice sociale très largement partagés dans notre pays. En ce sens, cette réforme s’inscrit dans le long processus mené par notre pays pour mener une démocratisation de son enseignement et de l’accès aux savoirs. Toutefois, à y regarder de près, deux périodes méritent à cet égard d’être considérées. L’une s’étend de la période révolutionnaire jusqu’au mitant des années 60 où l’on voit, lentement mais progressivement, s’améliorer le niveau de qualification académique et professionnel des jeunes français, en correspondance avec l’évolution économique. Période chargée de controverses véhémentes et de débats houleux, mais néanmoins marquée par un attachement et une confiance accordés unanimement, ou quasi, en l’Ecole de notre pays.
Des réformes qui ne font guère évoluer les contradictions fondamentales
La seconde est plus complexe. Les attentes sociales et économiques se font davantage pressantes, puisqu’il faut tout à la fois garantir une égalité d’accès aux enseignements donnés dans les collèges et les lycées et favoriser l’émergence d’une élite intellectuelle plus diverse dans ses origines sociales et géographiques, tout en formant toujours davantage de cadres pour l’industrie, le commerce et l’enseignement dont les besoins ne sont pas appelés à faiblir.
Une première vague de réformes a engendré la massification de l’enseignement secondaire pour atteindre un premier seuil de son développement au milieu des années 90, montrant que l’objectif visant 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat pouvait être atteint, mais sans que cela ne se traduise ni par une meilleure réussite de l’enseignement supérieur, ni par une meilleure insertion dans le monde du travail, même si l’on sait que la formation n’est pas l’unique cause, et de loin, du chômage massif et angoissant des jeunes de notre pays.
Depuis, les réformes de l’enseignement s’enchaînent à un rythme accéléré, sans jamais produire les effets escomptés : la part des bacheliers généraux dans une classe d’âge ne progresse plus depuis 20 ans (mais avec un taux de réussite bien plus élevé …), l’échec demeure massif dans l’enseignement supérieur et la qualité de nos enseignements régresse dans les comparaisons internationales, au point que même nos meilleurs élèves régressent dans évaluations conduites par PISA.
Faire émerger une nouvelle stratégie
Evaluer, innover et réformer sont à la source du progrès de nos sociétés, c’est dire combien nous sommes favorables à l’idée même de réforme mais aussi comptables de celles qui sont à l’œuvre et dont les effets ne peuvent pas être masqués ; c’est une question qui renvoie à la loyauté et à la rectitude dont doit manifester la preuve le monde de l’enseignement à l’égard des élèves et des étudiants.
La dernière réforme du lycée s’est emparée de la question cruciale consistant à concevoir un lycée alliant formation des élites et formation pour tous, en prescrivant une dose assez massive des exigences portées par les programmes de mathématiques et de sciences (comme on le pratique depuis près de 25 ans …) et des enseignements d’accompagnement personnalisés qui, pour qu’il en soit bien ainsi, viennent dévorer les heures que l’on prélève sur les enseignements fondamentaux. Les premiers constats ne sont guère rassurants :
– l’orientation vers les filières générales des lycées ne s’améliore pas, tandis que la section S en devient la formation de référence, sans pour autant qu’elle ne dégage davantage de flux d’orientation vers les études scientifiques. A cet égard, les données d’Admission Post Bac sont hautement instructives. Elles mettent en lumière une baisse d’attractivité inquiétante, pour l’économie de notre pays, des filières de la physique et de la chimie. On aurait sûrement tort de ne pas en imputer une large part aux programmes et aux horaires des disciplines concernées.
– loin de se réduire, les écarts entre les établissements, et des classes au sein d’un même établissement, ne font que s’accentuer sous l’effet de l’emploi que l’on fait localement des heures d’enseignement non directement fléchées. Le phénomène est devenu à ce point visible que les filières électives de l’enseignement supérieur ont déjà acquis une bonne connaissance des nouvelles pratiques horaires conduites dans les lycées.
– en classe préparatoire, en école en cinq ans ou à l’université on note une difficulté nouvelle en sa prépondérance chez les étudiants : peu rompus à la mémorisation des connaissances fondamentales, à l’appropriation progressive des notions complexes et au travail conceptuel, ils sont désormais très nombreux, en deuxième année, à ne plus assimiler dans la durée les connaissances nécessaires à la satisfaction des compétences attendues.
Certes la réforme du lycée a été suivie d’une profonde refonte des programmes et de l’agencement des classes préparatoires, du premier cycle des Ecoles en cinq ans et de nombreux parcours de Licences scientifiques et technologiques. Les professeurs ont su aménager les enseignements donnés durant le premier semestre pour développer chez leurs étudiants les bonnes pratiques et méthodes de travail, les encourager aussi et souvent combler certaines de leurs lacunes parfois cruciales. Accueillir les élèves tels qu’ils sont et les mener sur les chemins de la réussite constitue une ambition très forte que partagent les établissements concernés. Ils ont su placer au coeur de leur projet cette politique par essence volontariste et en faire un élément considérable de leur attractivité.
Mais au total, la situation n’est guère satisfaisante, puisque nos étudiants ne sont pas plus nombreux qu’hier et que nous ne parvenons pas à les former tous aussi bien qu’hier. Seuls les tous meilleurs d’entre eux n’ont rien cédé dans ce nouveau schéma construit depuis 2010. Cela ne fait que conforter l’efficience des formations les plus prestigieuses données en Classe Préparatoire puis en grande école, dans les grandes écoles en cinq ans et dans les meilleures formations données en IUT ou à l’université. Personne n’en doute : ce n’était pas le but de cette réforme que d’en administrer une nouvelle preuve.
Le temps d’une profonde réforme de l’Enseignement est encore en attente, elle gagnera sans doute en s’inspirant des travaux conduits par la CGE et le Comité en charge de la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur.
Michel Bouchaud
Proviseur du Lycée Louis-le-Grand
Président de l’APLCPGE
A propos de Michel Bouchaud
Après avoir enseigné les mathématiques pendant quatorze ans en lycée (Delacroix de Drancy et Léon Blum de Créteil dans les sections terminales C et D) et en IUT (Villetaneuse, département informatique), il devient personnel de direction en 1990. Proviseur depuis 1993, il dirige successivement les lycées Blanqui à Saint-Ouen, Parc de Vilgénis à Massy, Faidherbe à Lille, puis Montaigne à Bordeaux. Il est proviseur du lycée Louis le Grand depuis septembre 2012.
Membre de l’Association des Proviseurs de Lycée à Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles depuis 1997, il en est le président depuis cinq ans, après en avoir été vice-président pendant deux ans. Il siège également depuis cinq ans au Conseil d’administration de la Conférence des Grandes Écoles, il est membre de la commission Amont où il co-anime la commission en charge du suivi de la réforme du Lycée et de l’entrée dans le Supérieur (CPGE et Écoles en cinq ans).
Membre du Comité de concertation et de suivi des classes préparatoires aux Grandes Écoles
Membre du Comité de pilotage du dispositif « Admission-postbac »
Membre du Comité en charge de la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur
Ancien membre du Haut comité pour l’éducation, l’emploi et l’économie
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur
Officier dans l’ordre des Palmes académiques