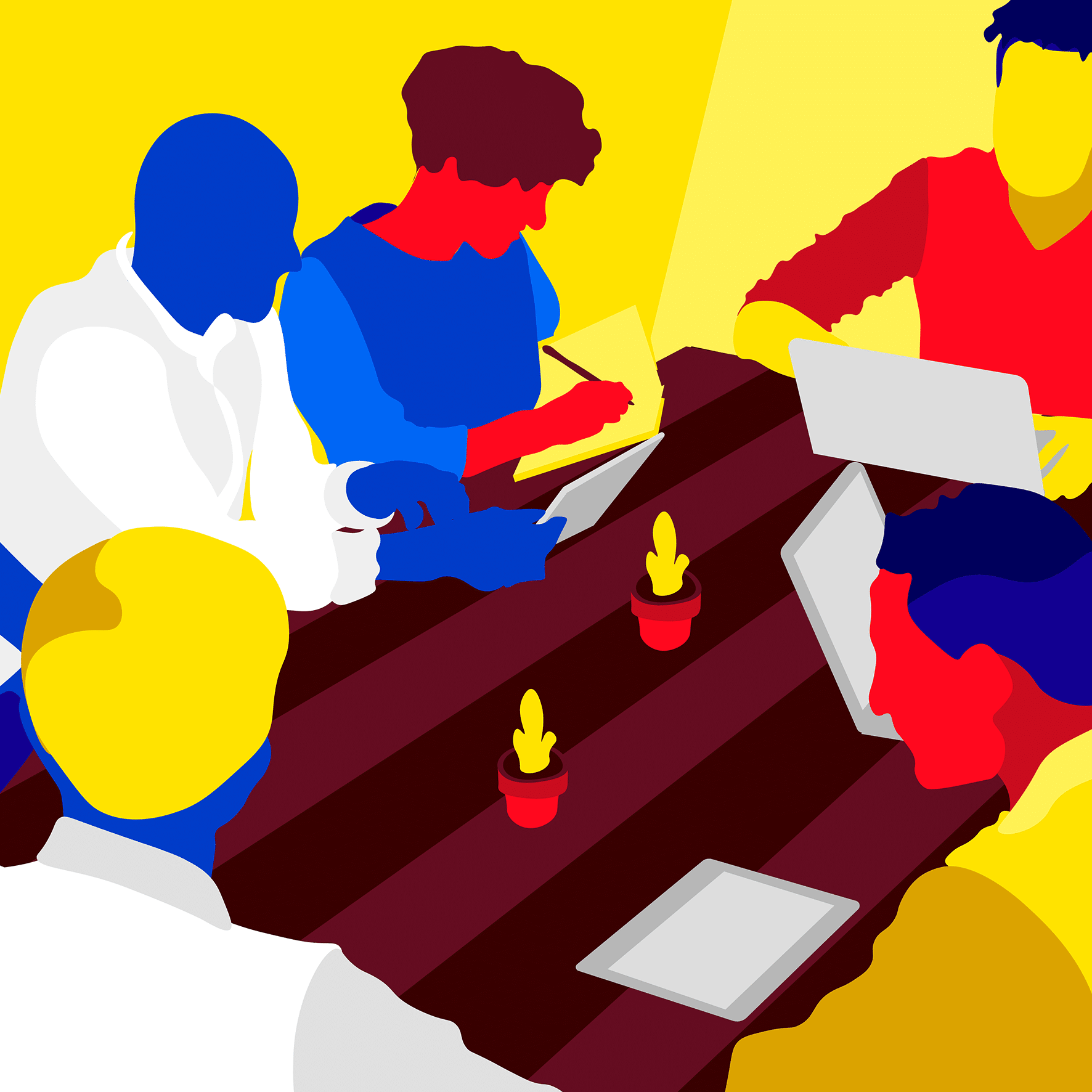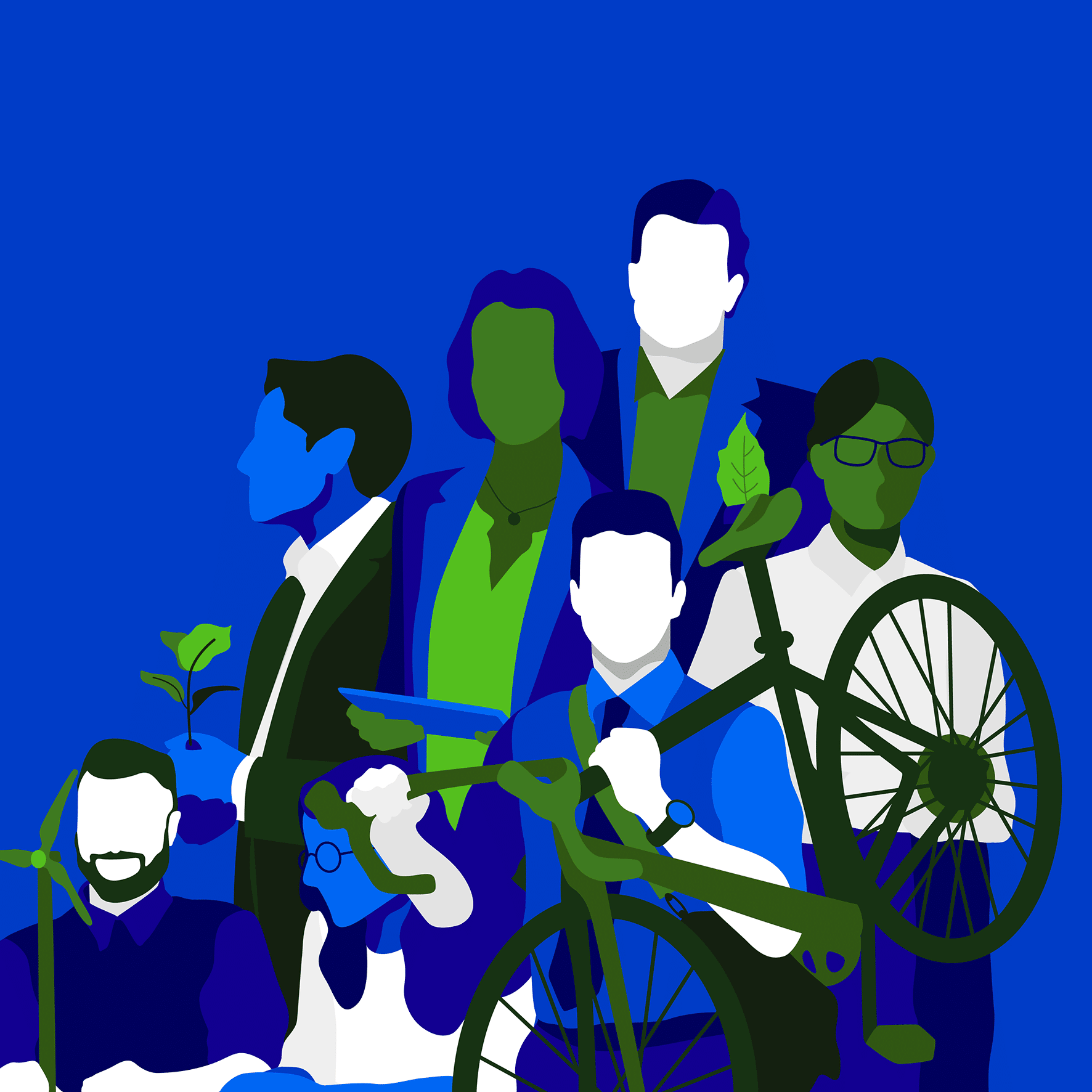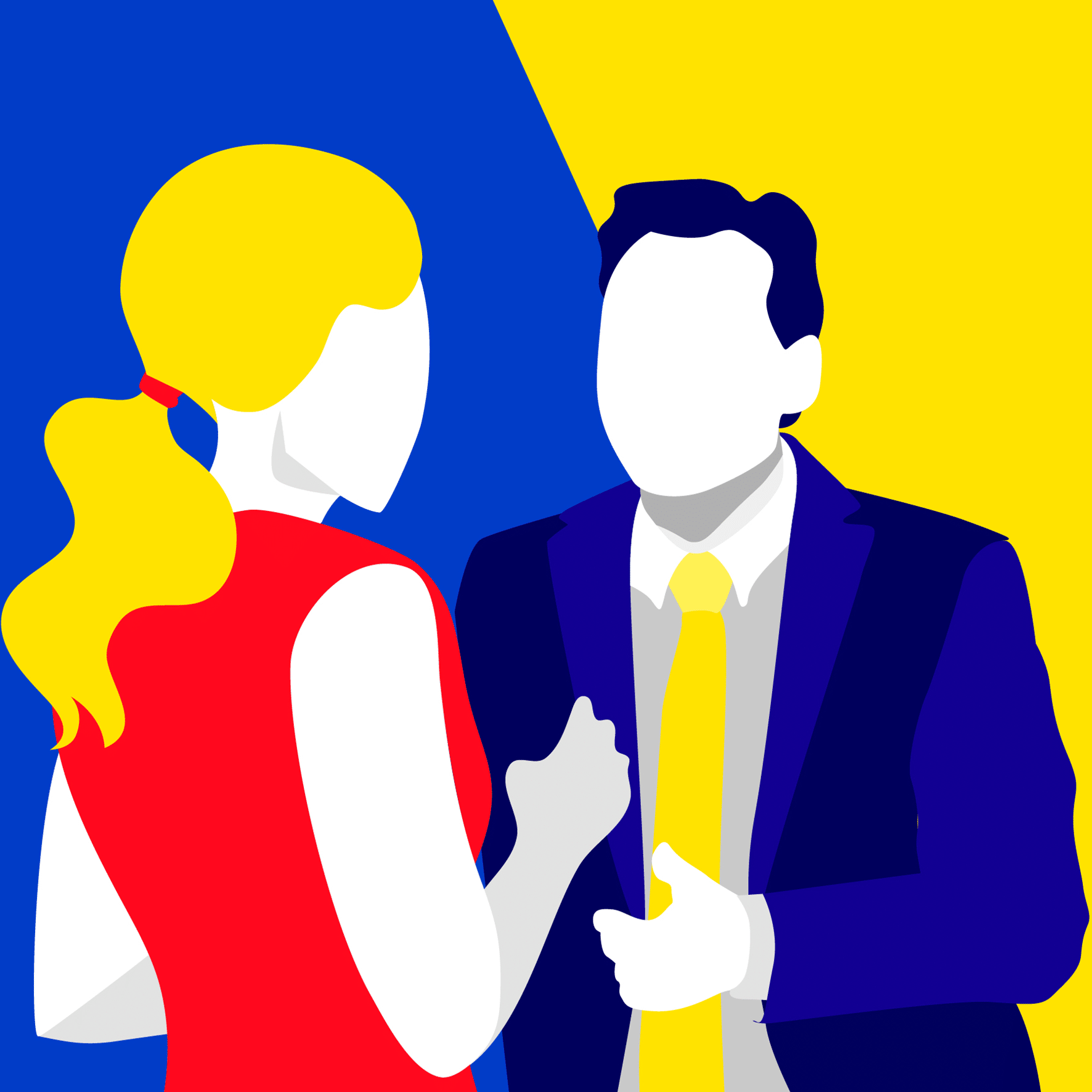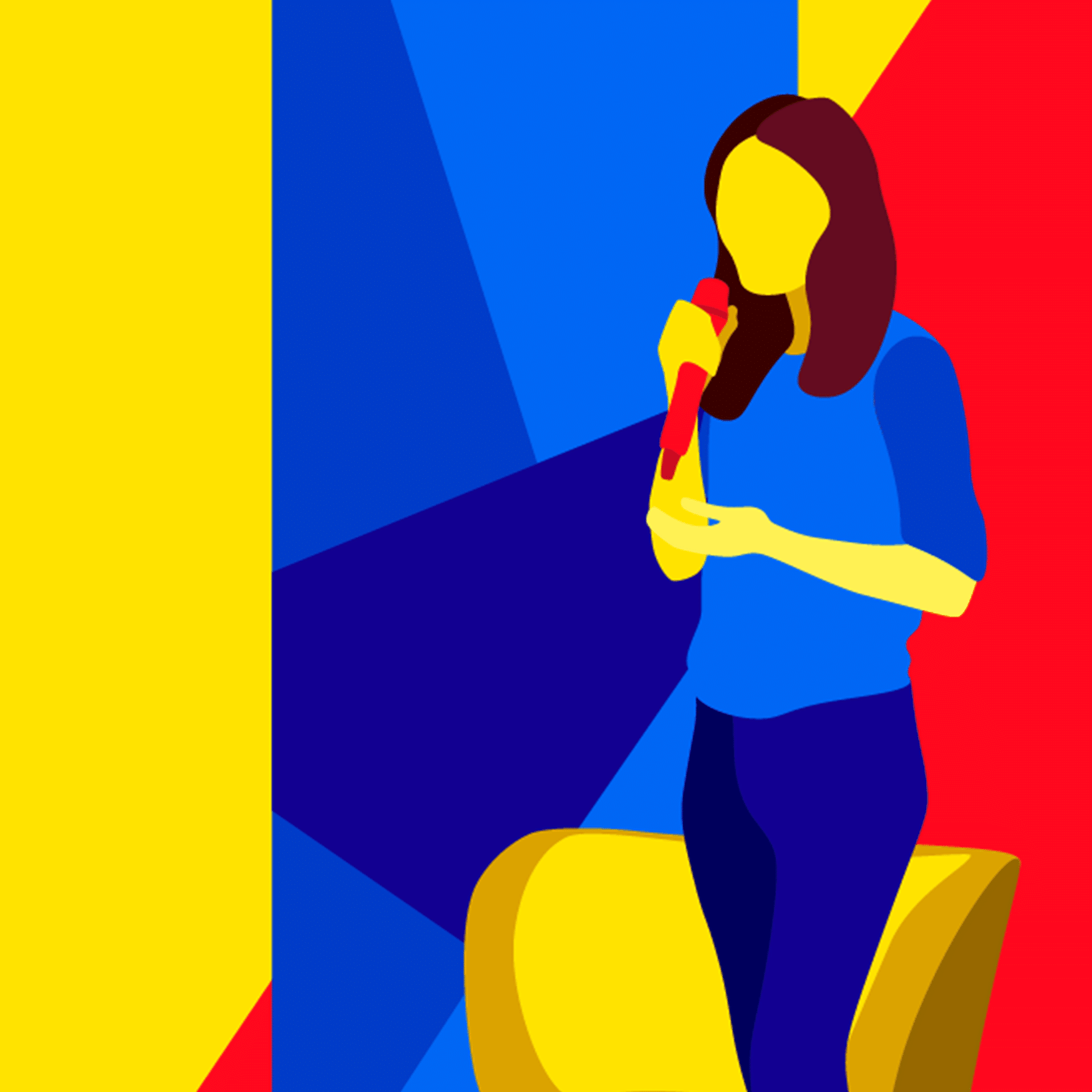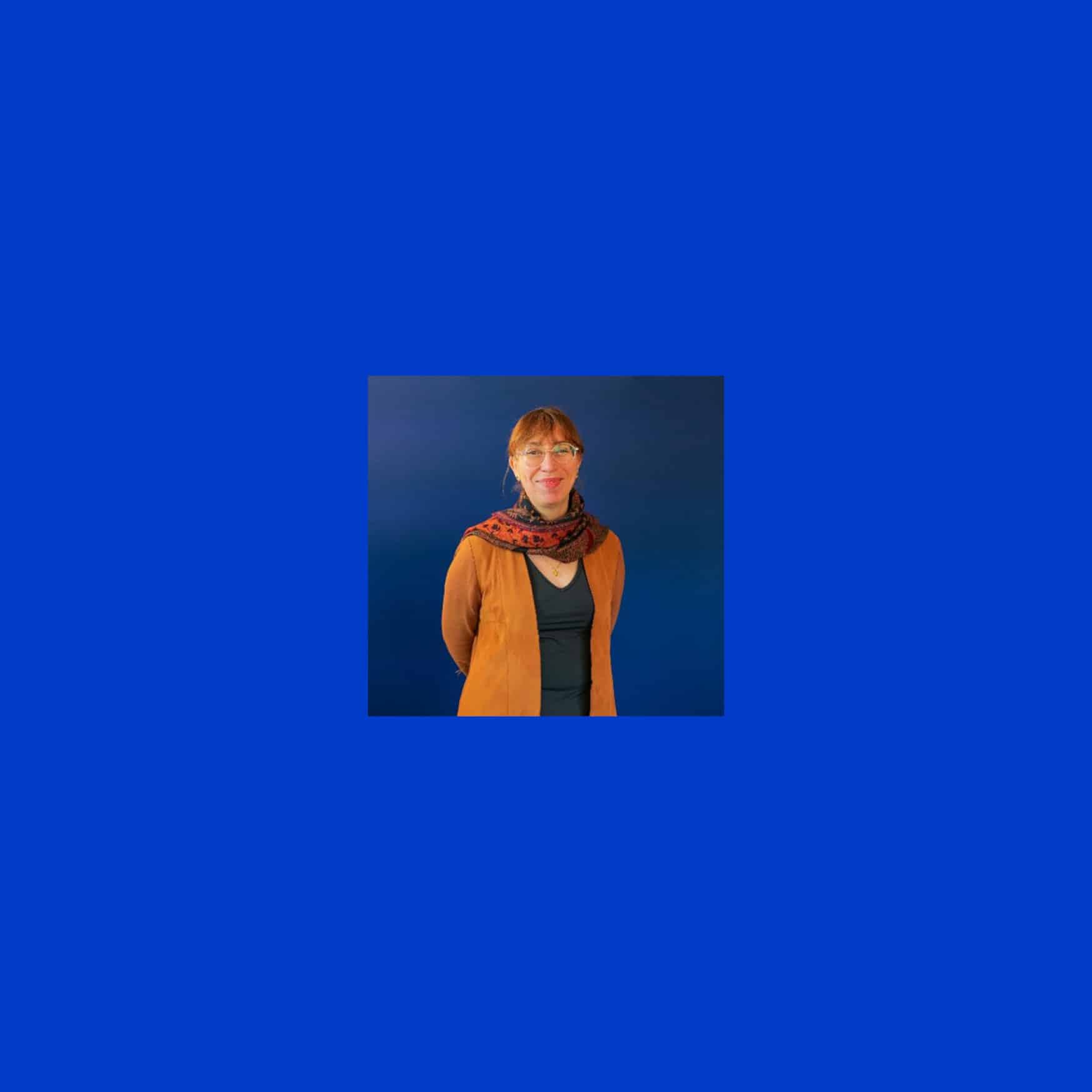Pierre Lefèvre est journaliste pour la presse écrite, la radio et la télévision, spécialisé sur les questions de développement durable depuis 15 ans. Ses thèmes de prédilection : changement climatique, biodiversité, urbanisme et architecture durable, santé, eau, agriculture, biomatériaux, biocarburants, carbone, arbre, forêt, énergie… Également auteur scientifique, il collabore à plusieurs magazines jeunesse et adulte dédiés aux sciences et à l’environnement, notamment Sciences et vie, Alternatives économiques, Phosphore ou encore le magazine d’architecture et d’urbanisme écoresponsable, Ecologik. Il a reçu en 2004 le prix du Livre d’environnement pour son livre « Un nouveau climat ? » paru aux éditions de La Martinière. Il signe par ailleurs un ouvrage aux éditions du Cavalier Bleu : « Parcours d’architecte » dans lequel il recueille les confidences de onze architectes sur leur vie et leur travail. Il enseigne le développement durable à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est passionné de montagne et d’escalade.
CGE : Pourriez-vous nous parler de votre parcours et de la façon dont vous vous êtes spécialisé dans les sujets liés au développement durable ?
P.L. : Je suis arrivé très tardivement au métier de journaliste. J’ai d’abord eu une formation très classique d’ingénieur généraliste à l’ENSICAEN. J’y ai notamment suivi des cours en automatique qui m’ont conduit à travailler sur des modèles de mesure de la pollution atmosphérique : mes premiers pas professionnels dans l’environnement en somme. Par la suite, mon service national, que j’ai effectué comme coopérant, m’a conduit en Haïti pour une société d’informatique : un pays d’une pauvreté extrême mais aussi d’une grande richesse culturelle. Ce fut un choc personnel énorme. J’ai rencontré là-bas une ethnologue qui m’a transmis la passion de son métier. A mon retour en France, j’ai toutefois commencé à travailler comme ingénieur conseil en innovation industrielle. Je m’occupais notamment de transfert de technologies pour des grands groupes internationaux. L’essentiel de mon activité portait sur des questions environnementales ou sur l’énergie. Mais j’avais gardé de mon séjour en Haïti l’envie de m’orienter vers l’anthropologie sociale ; d’autant que la dimension humaine était souvent, à tort, absente de certaines des missions d’audits que j’effectuais, ce qui manquait à mon diagnostic final. C’est ce qui m’a poussé à sauter le pas pour me former à l’anthropologie sociale, en faisant un DEA à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Au lieu de rédiger un mémoire théorique, comme beaucoup d’étudiants, j’ai préféré partir en Guinée Conakry, au Fouta Djalon, pour étudier un projet de développement. Je voulais faire de la recherche appliquée, une approche alors plutôt méprisée en dehors de quelques cercles restreints.
Le DEA en poche et plein d’enthousiasme, je me suis associé avec deux anthropologues pour monter une structure associative de recherche appliquée spécialisée sur les questions de développement. L’idée était que nos évaluations de projets puissent nourrir des thématiques de recherche et qu’en retour ce travail académique permette de produire des outils utiles pour les opérateurs de développement. Nous avions convaincu des chercheurs du CIRAD, de l’IRD et de l’Université de Laval au Québec de rejoindre notre comité scientifique. Malheureusement, l’expérience a tourné court au bout de cinq ans : notre modèle économique n’a pas résisté à la concurrence des universités. A cette époque j’avais commencé à écrire quelques papiers pour des revues scientifiques grand public en faisant valoir en premier lieu ma formation d’ingénieur. J’ai commencé par de petits articles au début pour Eurêka, un magazine qui n’existe plus aujourd’hui. J’ai écrit par la suite pendant 2 ou 3 ans pour Sciences et Vie Junior, un magazine destiné aux 12-16 ans. Ce fut très formateur. Ecrire pour les jeunes oblige à être rigoureux et simple à la fois. Il ne doit pas y avoir de « boites noires », des notions supposées connues. Ce fut pour moi une bonne école de journalisme. Je travaille aujourd’hui pour des magazines comme Sciences et Vie ou Ecologik, un magazine d’architecture et d’urbanisme éco-responsable. Par ailleurs j’écris occasionnellement des papiers pour Alternatives économiques. Pour tous ces supports l’approche journalistique reste assez classique, j’entends par là avec peu de transversalité. Ce n’est pas le cas des reportages que je réalise pour RFI, là j’ai la liberté d’aborder une problématique à partir de points de vue multiples, qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. Dernièrement j’ai été contacté pour écrire une série de trois documentaires pour France 5 sur le développement durable en Méditerranée. Je trouvais l’approche de la société de production très convenue et restrictive. Aussi, je leur ai proposé de parler autrement du développement durable, notamment en partant du point de vue des utilisateurs. J’ai abordé la question de l’eau par exemple, non pas sous l’angle uniquement technique mais aussi politique en m’intéressant à la question de la gouvernance, des modalités de partage de l’eau à travers différents exemples concrets et à différentes échelles territoriales. Je souhaite ainsi surtout permettre aux spectateurs de porter un regard différent sur ce genre de problématique en sortant des poncifs et en partant de ce que vivent les acteurs eux-mêmes.
CGE : Selon vous y a-t-il une spécificité propre au journalisme portant sur le sujet du développement durable ?
P.L. : J’ai le sentiment qu’il y a deux types d’approches journalistiques, dans ce domaine. La première, qui est sans doute la plus répandue, est une approche très militante. Il s’agit de dénoncer des pratiques en lien avec l’actualité environnementale, comme des pollutions catastrophiques, la destruction des forêts primaires. Elle a certainement toute sa légitimité, mais ce n’est pas la mienne. Je préfère proposer aux lecteurs de réfléchir par eux-mêmes en leur donnant des éléments d’analyse, en leur proposant de prendre du recul, en remettant en cause certaines idées reçues. Mon objectif est de montrer la complexité de ces sujets. Complexe ne veut pas dire compliqué : il faut toujours garder en tête que l’on s’adresse au grand public. Ainsi la biodiversité est souvent présentée comme étant une donnée purement biologique alors qu’elle est aussi une construction sociale et culturelle. Dans la série pour France 5, je me suis ainsi attaché à montrer avec des exemples concrets comment l’homme peut aussi contribuer à cette richesse en biodiversité sur le pourtour Méditerranéen, à travers ses pratiques agricoles mais aussi des mises en défense de territoires liées à des pratiques religieuses comme pour les paysans du sud marocain dans l’arganeraie. Le documentaire montre que les écosystèmes sont aujourd’hui menacés en Méditerranée, pour l’essentiel du fait d’un dérèglement de l’économie qui s’est déconnectée progressivement de son substrat écologique. Les systèmes agro-sylvo-pastoraux « traditionnels », comme ceux pratiqués en Estrémadure en Espagne ou dans l’Atlas au Maroc, par exemple, ont beaucoup de choses à nous apprendre. Dans un système agro pastoral, il y a toute une gamme de services écosystémiques entretenus par les agriculteurs, pour lesquels ces derniers ne sont pas rétribués alors que la collectivité en profite largement. Il s’agit par exemple du maintien de la qualité de l’eau des nappes phréatiques, de la limitation des incendies ou encore de la qualité esthétique des paysages, dont nombre de touristes peuvent profiter. Ces systèmes ne sont donc pas fragiles économiquement comme on les présente le plus souvent. C’est plutôt le modèle économique actuel qui peine à rétribuer les services écosystémiques et ceux qui en sont les gardiens.
CGE : Cette forme de journalisme exige du temps et une approche systémique, les modes de productions journalistiques actuelles le permettent-ils ?
P.L. : Mis à part la presse spécialisée ou certaines chaînes documentaires, les médias ont tendance à traiter ces sujets rapidement en enfonçant des portes ouvertes, en jouant sur la peur et le sensationnel pour attirer le chaland. Ce n’est pas toujours du fait d’une ignorance des journalistes mais de la ligne éditoriale imposée par le média. Quant à l’approche systémique, c’est encore plus compliqué car même la presse écrite spécialisée fonctionne par disciplines, un sujet sera étiqueté « sciences », « société » ou « économie » mais rarement les trois à la fois. La taille moyenne des articles est aussi un frein. Elle ne permet pas de développer suffisamment les sujets et oblige à des raccourcis parfois caricaturaux. Je ne suis cependant pas pessimiste ; il y a toujours des journaux comme le Monde diplomatique ou des magazines comme Alternatives économiques dans lesquels on peut traiter des sujets dans toute leur complexité.
CGE : Tous les journalistes peuvent-ils traiter ce thème ?
P.L. : Dans l’absolu oui, à la condition d’avoir suffisamment d’expérience ou un cursus approprié, car le développement durable, la vision systémique et les enjeux associés ne font pas encore partie d’une culture partagée par l’ensemble des citoyens, journalistes y compris. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de culture basique sur le sujet. Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot ont eu le mérite de sensibiliser le public à ces thématiques, même s’ils se sont parfois montrés caricaturaux. Mais maintenant il faut rentrer à la fois dans la complexité et la déculpabilisation et je crois qu’il y a une vraie attente du public en ce sens. Il faut développer une culture politique de l’écologie qui laisse place à l’action du citoyen. Sur les modes de gouvernance par exemple nous pouvons agir. Que puis-je faire, en tant qu’individu, contre la disparition des ours blancs ? Pas grand-chose, par contre je peux, par mon vote, mon action associative, pousser dans le sens d’une démocratie participative.
CGE : Les journalistes ont-ils des sujets tabous ?
P.L. : Non, par contre dans certains magazines, le pouvoir des annonceurs peut orienter le contenu éditorial. Ce qui bloque, de façon générale, c’est plutôt la complexité des sujets, l’impossibilité de mettre un article dans une « case » existante et la vision qu’ont les médias de leur audience ou lectorat. Par exemple, à la télévision, on va vous dire qu’il faut s’adresser au spectateur « moyen » comme à un enfant de 10 ans. Pour justifier cette considération, on vous explique que ce spectateur moyen ne regarde pas vraiment l’émission, il fait autre chose en même temps : la vaisselle, le repassage… Pour revenir à la question, je remarque qu’il y a des sujets qui sont très peu traités, notamment ceux qui sont relatifs à la relation entre développement durable et pauvreté.
CGE : Un des thèmes de Rio+20 pourtant
P.L. : Oui, par exemple, en France, encore 200 000 logements insalubres ont des peintures au plomb fortement dégradées. On sait pourtant que ce genre d’exposition a des conséquences sanitaires irréversibles particulièrement chez les enfants. Pourtant, à ma connaissance, les médias n’ont pas réellement traité ce sujet, qui me paraît particulièrement révoltant en 2012. Ce lien entre pauvreté et environnement est au coeur des questions de développement dans les pays du Sud mais aussi, et on l’oublie souvent, même dans nos pays.
CGE : Quelles formations semblent, à vos yeux, les plus adaptées pour un journaliste qui veut traiter les questions de développement durable ?
P.L. : Au-delà d’une formation classique de journaliste qui vous donne la compétence pour traiter techniquement n’importe quel sujet, je pense que le développement durable nécessite une formation plutôt scientifique et surtout une maturité personnelle et intellectuelle pour observer la complexité des interactions entre les écosystèmes et les sociétés humaines, qui sont eux-mêmes très complexes. Le développement durable ne supporte pas le discours simplificateur et impose de garder en permanence son esprit critique, quelles que soient la qualité ou la renommée de la personne que l’on interviewe. C’est aussi une école du doute, de la remise en question et des chemins de pensée non conventionnels. Avoir la capacité de se poser les bonnes questions est essentielle sans forcément prétendre pouvoir y apporter de réponses. Pour terminer, ce qui émerge actuellement dans le développement durable, c’est la question de l’éthique. Une formation en philosophie avec un focus sur la question des systèmes de valeurs me semblerait donc très pertinente. Je pense que cela manque aux journalistes. Au moins une sensibilité ou un intérêt à cette discipline.
Actualités DD dans les écoles
L’Institut Arts et Métiers ParisTech de Chambéry a inauguré le jeudi 12 juillet son nouveau toit solaire. Equipé de 670m² de panneaux hybrides couche mince, ce toit produit jusqu’à 77 Kwc en continu. Réinjectée dans le réseau, la production couvre 25 % de plus que l’intégralité des besoins en énergie de l’Institut. Pour en savoir plus
L’EPF à Sceaux a inauguré un nouvel éco-bâtiment le jeudi 24 mai. Plus de 450 m² de locaux sur deux niveaux, où les architectes se sont attachés à respecter au mieux l’environnement et l’écologie (toiture végétalisée par exemple ). Pour en savoir plus
Un étudiant de l’ESC Chambéry Savoie se prépare au Sun Trip 2013, découvrir le monde en vélo solaire. En savoir plus.