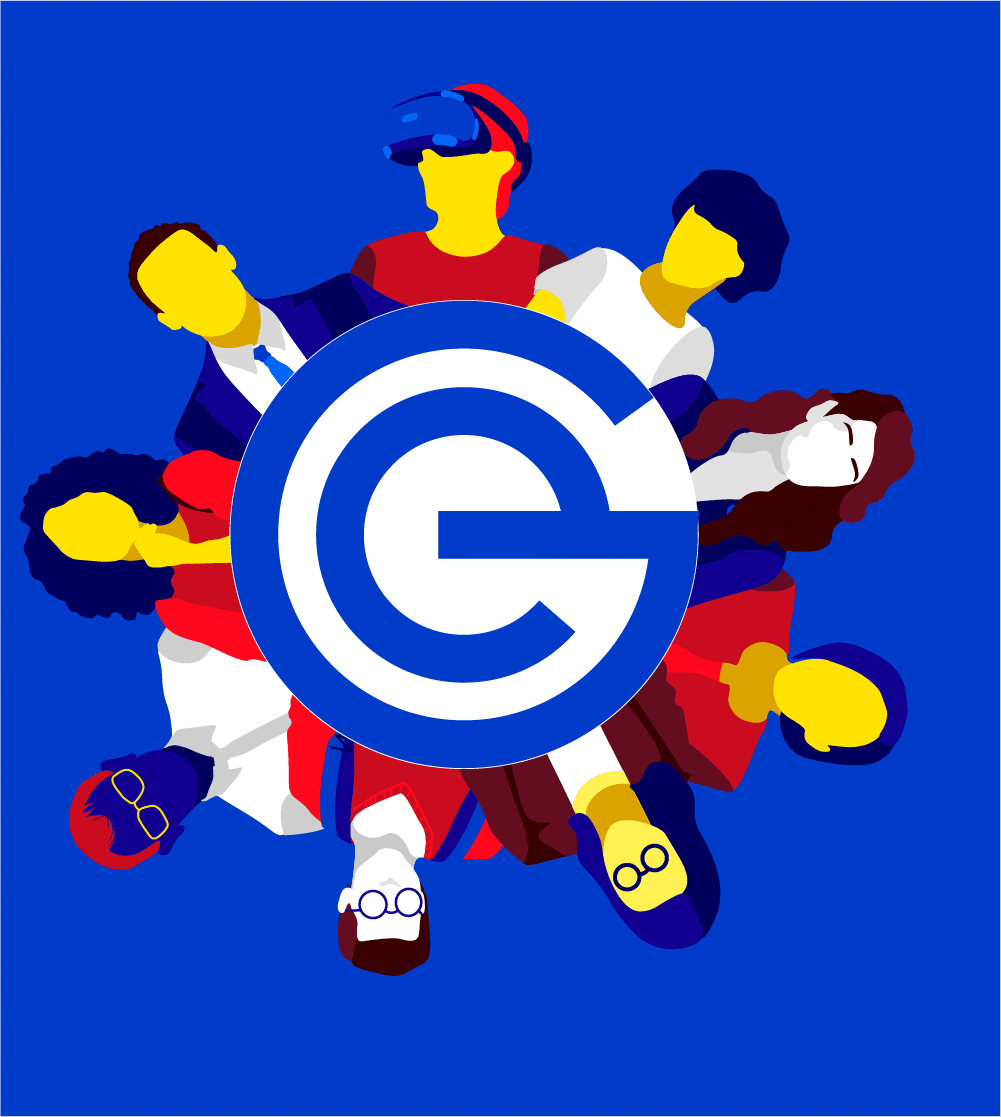CGE : Vous êtes directeur scientifique des Mastères spécialisés de l’ESIEA (École supérieure d’Informatique, électronique, automatique), des formations à finalités professionnelles, mais aussi un vecteur de spécialisation pour certains étudiants. Quelles sont selon vous les 3 principales valeurs ajoutées de ces formations dans un cursus ?
R.E. : Nous avons deux Mastères Spécialisés qui sont presque frères jumeaux : un en anglais et l’autre en français, mais ils ont quasiment le même contenu. Pour moi, les valeurs ajoutées sont :
– donner une grande technicité aux étudiants qui viennent chez nous, qu’ils soient jeunes diplômés ou en activité, notamment dans le domaine qui nous concerne, à savoir la sécurité de l’information. Ça leur permet d’accéder très rapidement à des postes d’expertise et aussi maintenant à des postes de responsabilité ;
– l’autre avantage d’un mastère spécialisé comme le nôtre c’est le réseau qui le fait vivre : celui des anciens d’une part et une cinquantaine d’intervenants qui animent nos ateliers d’autre part. Nous accueillons aussi des conférences sur les réseaux – pas forcément sur l’aspect de la sécurité d’ailleurs – Nous avons créé notre propre conférence sur la sécurité, que nous organisons en alternance à Laval et à Paris.
– Enfin, suivre un Mastère spécialisé, c’est aussi s’imprégner de l’alchimie qui se développe entre les personnes qui suivent la formation. Les profils sont très hétéroclites, même si l’on ne recrute quasi-exclusivement qu’à bac+5, ils se distinguent notamment par des cultures très différentes. C’est intéressant de voir dans ces projets, que nous individualisons au maximum, l’interaction avec les conférenciers, qui se lient très naturellement. C’est cette liberté que j’apprécie et qui permet de conserver une parfaite adéquation avec le marché du travail.
Chaque année, la formation se renouvelle et s’adapte aux nécessaires ajustements que réclame la sécurité des réseaux. Le grand intérêt du Mastère spécialisé, c’est de faire découvrir des gens très différents d’année en année, de révéler les talents et les projets novateurs. Toute notre formation se base sur une proximité avec la réalité des enjeux de la sécurité des réseaux. Mon discours est souvent le suivant : « On ne vous forme pas pour travailler l’année prochaine, on vous forme pour faire une carrière qui va durer encore 35 ou 40 ans. Et vous ne savez pas ce que vous ferez dans 5 ans ! ». Nous balayons donc un large spectre, avec un volume horaire très important, puisque notre MS se fait pratiquement à temps plein.
CGE : Vous avez indiqué, que vous dispensez votre Mastère spécialisé à la fois en français et en anglais. Quelle valeur ajoutée représente cette nuance linguistique pour vos étudiants ?
R.E. : Cette nuance nous permet de recevoir des anglophones non francophones au départ de leur formation. Internet a décuplé le nombre de demandes pour nos Mastères spécialisés : pour 20 places à Paris et 20 à Laval, nous avons souvent entre 100 et 200 demandes par an. Nous cultivons donc à la fois la qualité et la spécificité de nos formations et l’ouverture internationale, démarche nécessaire au développement à long terme de nos formations et de nos thèmes de recherche. En ce sens, nous avons signé un accord avec l’université de Plymouth, pour notamment développer une activité d’analyse de « malware » (virus, anti-virus…), l’une de nos spécialités distinctive et très en vogue.
Dans la pratique, je pense qu’il faut qu’il y ait mixage des eux promotions, que la promotion francophone croise l’anglophone pour quelques cours ou projets communs, c’est une autre manière de générer une alchimie bénéfique pour tous, dans le cadre de leur formation comme dans leur quotidien.
Le seul hic dans notre démarche de double formation (en anglais et en français ndlr), c’est que notre souhait d’internationalisation est parfois freiné par certaines incohérences de la part des autorités qui accordent les visas : parmi deux profils identiques (même diplôme, même pays, même université d’origine), l’un obtiendra un visa et l’autre pas ! Certains consulats délivrent des messages étranges comme par exemple : « C’est impossible, il n’existe pas de diplôme enseigné en anglais en France » ou « Vous ne parlez pas français, vous ne pouvez pas aller étudier en France ». Je ne les ai pas tous en tête, mais rien que sur Paris je crois qu’il y a au moins une petite dizaine de formations enseignées à100% en anglais !! Tant qu’on ne règlera pas les questions de délai et de cohérence pour l’obtention d’un visa, nous aurons des mauvaises surprises quant à la possibilité pour des étudiants étrangers inscrits de venir suivre nos formations. Quand on veut faire rayonner la France, il ne faut pas se regarder le nombril trop longtemps, sinon d’autres pays plus ouverts et plus ambitieux occuperont tout l’espace du marché mondial de la formation.
CGE : Votre parcours personnel a-t-il été plutôt linéaire ou bien l’informatique n’a -t-elle pas toujours été votre principal sacerdoce ?
R.E. : J’ai commencé par faire des mathématiques en licence, et j’avais gardé bizarrement un mauvais souvenir des cours d’informatique de ma deuxième année d’université, parce que je les trouvais très théoriques. J’aime bien la théorie mais je veux en comprendre l’usage et l’utilité. Je suis un passionné de mathématiques et notamment de cryptologie, mais j’ai redécouvert l’informatique par la programmation quand j’étais en maîtrise de mathématiques. J’ai pris une option « programmation algorithmique » qui est d’ailleurs le cours que je fais encore aux élèves de première annéesaujourd’hui, c’est vraiment ma passion. Enfin, j’ai fait un DEA, l’équivalent des actuels masters, en calcul scientifique. Je me suis alors un petit peu éloigné des mathématiques pures pour arriver aux mathématiques appliquées. Puis, par une succession de hasards, je me suis retrouvé à enseigner dans la sphère de développement de l’informatique, devenue la matière incontournable dans les écoles d’ingénieurs. Ma thèse a commencé à en souffrir, j’ai dû faire un choix. Je me suis donc engagé à l’ESIEA pour finir ma thèse et contrôler un peu le volume des cours que je délivrais. Je suis arrivé comme professeur de mathématiques et j’ai commencé une thèse en mathématiques, puis, j’en ai fait une en informatique. J’ai fait un choix, je me suis laissé un ou deux ans pour analyser le marché de l’information, mais j’ai hésité longtemps entre la sécurité et la bioinformatique. J’aurais tout à fait pu créer un mastère spécialisé en bioinformatique, mais j’avais très peu d’anciens élèves dans cette matière, alors que j’avais des dizaines d’anciens élèves qui travaillaient dans la sécurité. J’ai donc comblé un vide puisqu’il n’y avait pas d’enseignement en la matière à l’époque.
Je me suis donc éloigné de mes premières amours, mais cette évolution est très positive et a posé les jalons d’une véritable construction personnelle. On peut innover dans l’informatique et l’informatique doit être utile à l’innovation. Quand deux cerveaux travaillent sur le même programme, il y en a un qui va peut-être élaborer un programme qui tourne plus vite que celui du voisin… Quand il s’agit de traiter de très grandes masses de données, c’est un avantage commercial, pas seulement intellectuel. En l’occurrence si l’on veut lutter contre les pays qui pratiquent des bas coûts, il me semble qu’il faut miser sur l’intelligence. Et la formation à la française en informatique est pour moi la meilleure au monde. Ça ne veut pas dire que tous nos étudiants sont les meilleurs au monde, ça veut dire que si vous sélectionnez des gens capables de recevoir une formation de qualité, et que leur capacité d’innovation, leurs compétences et leur dynamisme seront à la pointe de ce qu’attendent les entreprises. Ce n’est pas un hasard si Google a, sans le préméditer, proposé une offre d’emploi aux trois derniers majors de l’ESIEA, qui se connaissaient à peine.
CGE : Si vous deviez définir vos plus grandes attentes vis-à-vis des étudiants qui suivent vos enseignements et la place de la transmission du savoir dans vos cours, comment le feriez-vous ?
R.E. : Dans le cadre du Mastère spécialisé, eu égard à l’âge des participants, au fait qu’ils ont tous déjà un diplôme de niveau bac+5, je ne peux pas me contenter de mandater un professeur qui présente des transparents et qui s’en va au bout de 3 heures , même s’il est génial. Je privilégie donc l’interaction entre les étudiants et l’expert, avec l’assistance d’un membre de l’équipe, non pas pour jauger l’expert, mais pour encourager la synergie dans la classe. Les salariés notamment sont très sensibles à cette approche : ils veulent rentabiliser au maximum le temps qu’ils passent dans leur formation pour optimiser les valeurs ajoutées dans leur univers professionnel, parce qu’ils savent qu’après ils vont retourner sur le marché du travail. Quand l’intérêt est là, le temps ne se mesure pas de la même manière et une question en introduit une autre…
L’équilibre des promotions est donc un véritable enjeu. Entre les incertitudes des jeunes diplômés et les attentes des salariés, il est plus facile de formaliser les besoins avec un échange et des perspectives plus globales autour d’un objectif plus collégial qu’il n’y paraît au départ.
CGE : Comment percevez-vous l’évolution de la France du point de vue des partis pris de l’enseignement supérieur ? Quelles seraient vos priorités pour influer sur les destinées de notre civilisation ?
R.E. : J’ai des partis pris naturellement, mais là immédiatement, je pense à une question que j’ai posée à plusieurs économistes : « un ingénieur au sens large ou un scientifique de moins formé chaque année, c’est combien d’emplois en moins dans 20 ans en France ? ». Voilà, une question simple et bête. Autrement dit, « si 25 000 diplômés, au lieu de 30 000, sortent des écoles d’ingénieurs l’année prochaine, ces 5 000 ingénieurs manquants se traduiront en combien d’emplois en moins dans 20 ans ?». Le problème de l’attractivité des études scientifiques est à résoudre d’urgence ! C’est bien d’avoir une super équipe de marketing et commerciale, mais s’ils n’ont rien à vendre, quelle sera leur avenir ? Je ne parle pas de production, je parle de création. Encore une fois, le maître mot des années à venir, va être l’innovation. La France forme des ingénieurs qui sont capables de répondre à ces enjeux, mais Il est dommage de constater que le tissu industriel n’est pas forcément capable de les accueillir ni de les conserver en France. Jadis, le départ vers l’étranger, c’était l’aventure, aujourd’hui c’est l’aller simple pour fuir la réalité d’un pays qui n’a pas les bonnes priorités !
Quand je regarde du côté des Anglo-saxons, je vois des fossés d’incompréhension qui pourraient, de mon point de vue, être aisément comblés. Une question simple : en France peut-on être polytechnicien après avoir fait un master ? Non. En revanche, vous pouvez faire votre thèse à Polytechnique. C’est ce que m’a fait remarquer un Américain, qui m’a raconté : « J’ai fait la faculté la moins reluisante de New York, parce que c’est la seule que j’ai pu me payer. J’ai fait 2 ans. Ça s’est très bien passé. Puis, un de mes professeurs m’a dit ‘Va à Stony Brook, ce n’est pas la meilleure faculté de New York, mais c’est quand même mieux que de continuer ici’. Il était conscient de mon niveau et je suis sorti major de mon Bachelor. Puis, j’ai fait mon master à New York University, qui est un des meilleurs établissements américains. Enfin, j’ai fait ma thèse au MIT (Massachusetts Institute of Technology). Vous pouvez faire ce type de parcours en France, me demande-t-il ? ». J’ai répondu que oui, mais qu’il y a une différence fondamentale entre faire sa thèse à Polytechnique et être polytechnicien.
Il est difficile d’orienter ou de convaincre quelqu’un de choisir un cursus plutôt qu’un autre. Résultat, aujourd’hui, nous pouvons prévoir les manques à venir dans certaines corporations comme les médecins, mais on est incapable de « gérer le numerus clausus » ou de faire des prévisions à long terme, pour générer une phase d’anticipation indispensable et mettre en œuvre les outils ou les réformes nécessaires. Qu’on le veuille ou non, nous sommes dans un système mondialisé, l’enseignement supérieur français doit s’ouvrir pour défendre les bonnes pratiques qui conduisent à la réussite et au bien-être collectif.
CGE : Qu’auriez-vous aimé inventer ? Qu’aurions-nous dû ne jamais inventer ?
R.E. : Je répondrai à ces deux questions par une seule et même réponse : l’algorithme qu’il y a derrière Google. Je reconnais que c’est assez incroyable de constater qu’ils ont utilisé une technique assez ancienne pour l’adapter à Internet et de voir l’efficacité qui en résulte. En revanche, je suis moins d’accord avec les dérives possibles de ce formidable outil. J’aurais beaucoup aimé travailler à la création de ces algorithmes parce que cela aurait été irrésistible. Si on me l’avait proposé, je n’aurais pas pu dire non. Mais aujourd’hui, avec le recul, je me rends compte que ces scientifiques ne sont pas plus éclairés que les non-scientifiques, que l’on accuse souvent de manquer de discernement. On transforme finalement une vertu initiale en quelque chose d’un peu tronqué. Ceux qui ont participé à ce projet excitant et qui, pour certains, ont compris, mais trop tard, la finalité de cet outil, doivent certainement être effondrés. Avec Google, nous n’avons plus le droit à l’oubli numérique. C’est un terme que j’avais aussi imaginé il y a quelques temps et qui redevient à la mode. Google vous le refuse. Et ce n’est pas une exception, Facebook est peut-être encore plus dangereux…
Il nous reste à inventer le post-google, parce qu’il y en aura un… J’espère… Le prochain défi sera de l’imaginer.
Découvrir l’ESIEA
L’ESIEA, habilitée depuis 1986 par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), reconduite pour six ans en mars 2006, à délivrer le diplôme d’ingénieur ESIEA, compte aujourd’hui plus de 6 000 diplômés.
L’ESIEA est l’Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique. Créée il y a plus de 50 ans, c’est une Grande Ecole d’Ingénieurs reconnue par l’Etat. A ce titre, elle accepte les boursiers d’Etat pour ses établissements de Paris et Laval.
L’école forme des ingénieurs généralistes pour lesquels l’IEA (Informatique, Electronique, Automatique) est un instrument global lié aux Nouvelles Technologies. Ce sont des domaines interconnectés avec des complémentarités et des similitudes qui permettent d’appliquer les connaissances acquises à des domaines très variés.
Cette formation technico-scientifique de haut niveau s’accompagne d’enseignements en ressources humaines, management et entreprenariat qui sont tout aussi indispensables aux ingénieurs d’aujourd’hui.