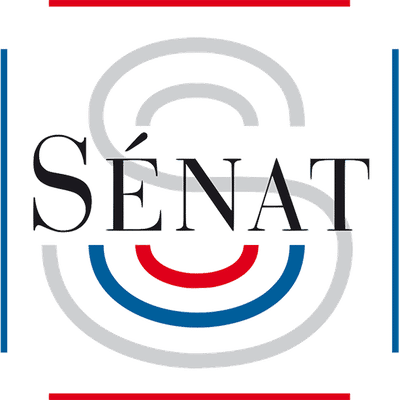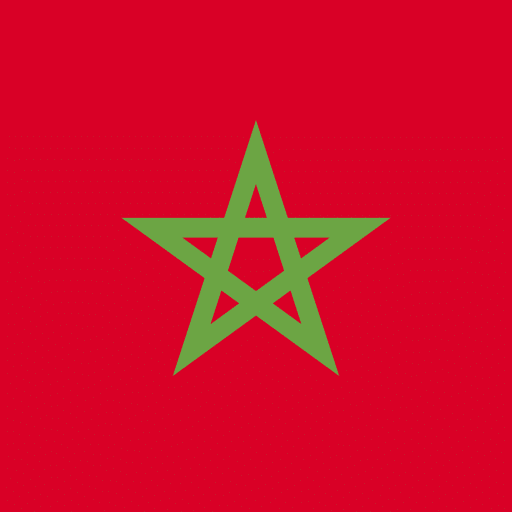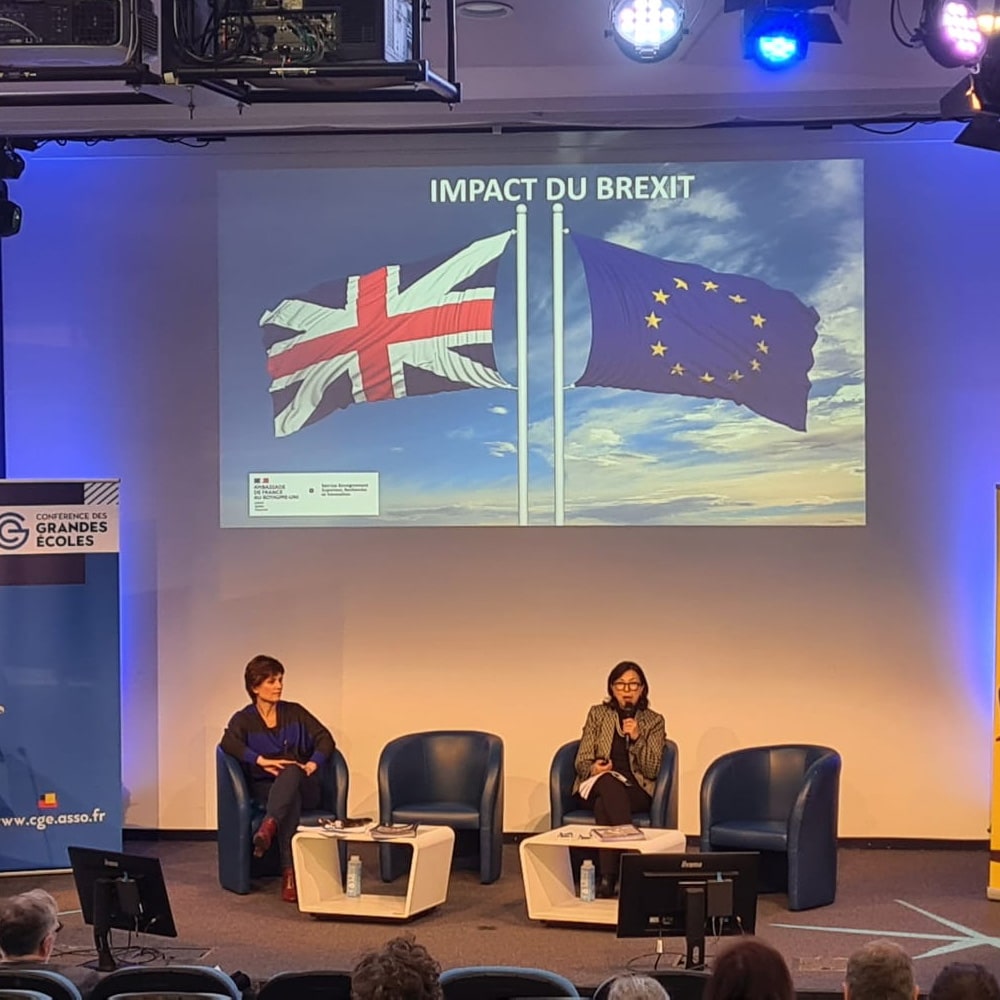Diplomate, ministre plénipotentiaire, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et spécialiste des questions internationales, de la géopolitique, de la construction européenne et de la mondialisation, il est l’auteur de très nombreux livres dont Introduction à la géopolitique (Points, 2009) ou 25 Questions décisives : la guerre et la paix (Armand Colin, 2009).
CGE : La fameuse phrase de Napoléon « Tout État fait la politique de sa géographie », suffit-elle toujours à résumer la notion de géopolitique ou l’émergence des techno-pouvoirs conduit-elle progressivement à la disparition de cette notion de notre horizon intellectuel ?
P.M.D. : Cette phrase reste parfaitement actuelle et juste car les États sont toujours enracinés dans un territoire. La politique d’un État est donc bien déterminée par sa position géographique. Ce que n’évoque pas la phrase de Napoléon, au regard de l’époque pré-industrielle où elle a été prononcée, c’est la multiplication des flux et des échanges de marchandises, d’idées, de personnes… Napoléon ne pouvait être conscient de la modification possible de l’administration des territoires par cette explosion des flux.
Par ailleurs, parler d’Internet comme un techno-pouvoir ne veut rien dire, il faut déterminer ce qu’est un pouvoir : un pouvoir, c’est une entité qui s’incarne. Un État est un pouvoir, une entreprise est un pouvoir… Internet est un réseau manipulé par des acteurs, non pas un acteur au sens d’un État ou d’une entreprise. Certes, ce réseau permet à des groupes d’individus de s’exprimer alors qu’ils ne pouvaient le faire auparavant, créant ainsi un jeu planétaire démocratique sauvage que les États doivent désormais prendre en considération, mais il ne faut pas confondre la modification de l’environnement technique et les acteurs qui la conduisent.
Les États s’adaptent donc à cette nouvelle situation et tentent de la contrôler. Comment vont-ils procéder ? Il n’y a que deux manières : soit ils vont se fermer complètement, se coupant des réseaux, mais le coût astronomique et les conséquences d’une telle stratégie sont clairement impossibles à mettre en œuvre. L’autre alternative réside dans la coopération internationale, pour permettre de créer des règles administratives et des mécanismes capables de surveiller ces réseaux. D’une certaine manière, le jeu ou la « vieille rivalité » entre État et acteur sauvage est toujours d’actualité.
Les États ont-ils vraiment les ressources pour y parvenir ? C’est très difficile à estimer… Pour établir des règles et une coopération durable, ils devront modifier l’exercice du pouvoir étatique et trouver des accords de collaboration ou d’action à plusieurs, quand individuellement ils seront par nature impuissants, vidant ainsi de tout son sens les arguments de défense d’une souveraineté du pays. Il suffit de suivre l’actualité pour voir à quel point la souveraineté est à la fois remise en cause par les peuples qui échangent par delà les frontières avec Internet notamment et par les États eux-mêmes qui s’engagent dans des mécanismes coopératifs pour répondre aux exigences de la croissance des flux.
CGE : Y a-t-il un moment-clé dans la détermination d’une intervention d’un pays dans un autre où l’on constate une détérioration de la situation intérieure et une montée en puissance des violences faites notamment aux populations ?
P.M.D. : Il est très difficile de répondre à cette question. Peut-être y a-t-il en effet un moment clé, mais la vraie question est celle de l’intervention. Faut-il ou non intervenir ? Aujourd’hui le bilan de toutes les interventions récentes, en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, est extrêmement négatif : elles se passent mal. Les populations sont très rétives et n’accordent pas ainsi leur confiance. L’intervenant, même s’il a de bonnes intentions, est perçu comme un occupant qui va repartir. Pour que la question du moment-clé se pose, il faudrait considérer qu’il peut y avoir de bonnes interventions, susceptibles d’imposer un consensus international suffisamment fort pour faire s’effacer toute tension stratégique. Prenons l’exemple de la Syrie : il n’y aura probablement aucune intervention extérieure. Pourquoi ? Parce que tous les intervenants potentiels savent qu’ils vont s’engager dans un bourbier… Le problème n’est pas d’entrer dans le pays mais bien d’en sortir ! La meilleure intervention est de ne pas intervenir…
Pour la Syrie, s’il y avait, ce qui ne sera pas le cas, un accord entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Union européenne, l’Inde et d’autres, une intervention serait peut-être possible, mais nous sommes là dans une hypothèse irréaliste.
Un autre exemple, celui de la Grèce : avec la crise de l’euro, l’Union européenne est amenée à intervenir en Grèce pour faire pression sur les autorités grecques pour que le pays applique des politiques plus raisonnables dans de nombreux domaines. Mais, en réalité, la seule bonne solution à la crise grecque, c’est que les Grecs eux-mêmes en prennent la mesure et la responsabilité pour trouver un équilibre entre la préservation de leurs populations et l’acceptation des dettes engrangées depuis de nombreuses années. Nous en sommes encore loin…
En somme, intervenir, c’est déjà un échec. En substance, c’est reconnaître que la population locale n’est pas capable de créer une situation satisfaisante, une façon de dire qu »elle n’est pas adulte. Une version humiliante susceptible de générer de vives tensions. L’intervention diplomatique est tout aussi difficile car le conseil ou l’accompagnement sont tout aussi des ingérences, sauf à recevoir l’acceptation de l’autre, ce qui pourrait, pourquoi pas, poser les jalons d’une clé d’intervention. Néanmoins toute intervention demeure inégalitaire, il y a l’intervenant et celui qui la subit. Pour les interventions dans le monde arabe, l’un des grands problèmes est le sentiment d’humiliation ou d’échec. Il faut donc savoir créer un rapport plus égalitaire. Nos pays du Nord doivent rester ouverts à ces populations du Sud et notamment aux étudiants étrangers, dont l’accueil fera l’ancrage de relations durables et pertinentes. La formation, les échanges, la circulation entre le Nord et le Sud de la Méditerranée sont un enjeu majeur, même s’il est évident qu’il est complexe de trouver les bons curseurs de l’immigration. L’un des grands vecteurs de développement économique, ce sont les diasporas. L’exemple de la diaspora sénégalaise très présente en France et ailleurs est très significatif pour favoriser la circulation.
CGE : La situation économique de l’Union européenne fait régulièrement l’actualité et pose de nombreuses interrogations sur les problématiques d’élargissement ou de sortie de certains pays. Pensez-vous qu’il y a des corollaires entre les situations de la Grande-Bretagne, avec ses conservateurs eurosceptiques souhaitant sortir de l’UE ; de la Croatie qui aimerait sortir du bourbier balkanique ; et de la Grèce, qui semble ne plus pouvoir émerger ?
P.M.D. : Une certitude pour moi, c’est que le Royaume-Uni ne peut pas sortir de l’Union européenne. C’est une évidence géographique car il paraît difficile de voir le Royaume-Uni se déplacer au large de la Californie pour devenir un État fédéré aux États-Unis, même si nombre de Britanniques pourraient en avoir le désir. Le grand atout du Royaume-Uni, c’est la City, point de passage entre les capitaux mondiaux et l’Europe. L’Europe a donc tout intérêt à garder le Royaume-Uni dans l’Union européenne et réciproquement. Pour éviter un total isolement, le Royaume-Uni a tout intérêt à rester dans l’UE en défendant à sa manière l’euro, même s’il ne l’adopte pas. C’est bien d’une Europe prospère dont a besoin le Royaume-Uni car si l’euro disparait, la City en souffrirait terriblement. Les Britanniques pouvaient vivre seuls lorsqu’ils avaient un empire, lorsqu’ils avaient un lien privilégié avec les États-Unis, mais cette situation est caractéristique du passé, donc les Britanniques sont de toute façon condamnés à rester dans l’UE.
Le point commun des trois pays que vous citez s’inscrit dans une réalité incontournable qui est l’UE. Elle existe, elle a ses défenseurs et ses détracteurs, mais ce n’est pas le plus important, sa réalité est riche : un marché unique, une monnaie unique… Ces trois acteurs de l’Europe sont donc voués à se définir par rapport à cet ensemble, décider d’en faire partie ou de ne pas en faire partie. De plus, avec le poids économique des 27 États membres, les territoires qui sont à la périphérie de cet ensemble ne peuvent l’ignorer. Si je prends un autre exemple : celui de la Suisse, totalement enclavée géographiquement dans l’UE et donc très dépendante de celle-ci. Nulle possibilité pour la Suisse de faire une politique ou des lois que n’accepterait pas l’UE !
Pour autant, l’UE devra trouver un point d’équilibre dans son élargissement pour sa cohésion et sa cohérence vis-à-vis du monde. En ce sens, la Turquie n’a aujourd’hui aucune chance d’entrer dans l’UE mais ce n’est pas le point le plus décisif aujourd’hui dans le destin de l’UE. L’un des défis majeurs de l’UE va être d’établir des rapports avec le Sud méditerranéen. Elle ne peut être prospère si cette zone géographique est pauvre et dans le chaos. Il faut que se crée un partenariat entre l’UE et, disons, le monde arabe, dont la ceinture part du Maroc et s’étend jusqu’à la Turquie ou à l’Iran. L’UE ne peut pas être une forteresse, elle a besoin d’échanges, de circulation et en priorité avec ses proches voisins. Pour ce faire, il faut à tout prix que le Sud méditerranéen crée un grand marché. Il y a eu des tentatives malheureusement infructueuses jusqu’à ce jour.
CGE : La Tunisie peut-elle devenir un Singapour méditerranéen ou le Qatar un Singapour arabe ?
P.M.D. : Cela suppose des conditions qui ne sont pour l’instant pas réunies. Singapour a bénéficié d’une situation tout à fait exceptionnelle avec des voisins pas trop agressifs, un environnement plutôt pacifique qui lui permet, malgré sa vulnérabilité, de profiter de la forte croissance de cette zone géographique. Singapour prend donc tout son intérêt en devenant une place économico-financière au service du développement de l’ensemble de la zone. Pour le monde arabe, le Qatar est-il capable de décrocher ce rôle ? Il est pour cela nécessaire que le monde arabe se transforme en profondeur et entre dans une phase de décollage et de modernité suivant l’exemple des pays de l’Asie du Sud-Est, mais nous en sommes encore loin.
CGE : Après le départ de dirigeants qui semblaient jusqu’alors invulnérables, la cartographie des pays capables de construire le cadre constitutionnel et les fondements du développement économique nécessaires, pour s’approprier de façon durable des régimes démocratiques, semble très inégale. Selon vous, quels sont les pays qui ont les meilleurs cartes ?
P.M.D. : Le Maroc, la Tunisie, l’Égypte devraient être des pays majeurs de cette mutation démocratique nécessaire du monde arabe, vers une modernité indispensable pour passer de nouveaux paliers. Cependant, dans chaque cas, il y a des freins terribles : au Maroc, la monarchie, en Égypte le poids de la démographie, en Tunisie la concentration des pouvoirs… La démocratie est impossible sans un minimum de prospérité économique. Pour bâtir une démocratie, il faut être en mesure de donner l’espoir d’une vie meilleure aux populations. Dans le sud de la méditerranée, il faut combiner l’édification de la démocratie avec une dynamique économique qui donne de l’emploi aux jeunes. Si les jeunes n’ont pas d’emploi, il n’y aura pas de démocratie.
CGE : Plus généralement, quel est le problème numéro 1 du monde actuel ?
P.M.D. : Selon moi, nous devons avant tout trouver les éléments de réponse à notre façon et notre capacité à créer des emplois pour les jeunes ? Le poids de la population des 15-30 ans est colossal. Nous sommes encore dans une phase de croissance démographique très importante, elle va diminuer avec les générations suivantes, mais elle est bien au cœur des problématiques actuelles. Pour moi, au-delà de la formation, la clé de cette création d’activités et d’emplois, c’est l’entrepreneur, le créateur de richesse : des individus qui imaginent, qui développent et qui sont encouragés en ce sens. De ce point de vue, la France a encore de nombreuses voies d’amélioration pour s’approprier la philosophie de cette dynamique.
D’une certaine manière la France se trompe en ce moment : il ne faut pas hésiter à faire l’éloge de certains riches plutôt que de les condamner sans distinction. Que ce soit chez nous, dans le monde arabe ou ailleurs, ce ne sont pas les États qui créeront de l’emploi, ce sont des gens qui auront compris comment les marchés fonctionnent, comment ils peuvent les utiliser, comment trouver des niches… Ce sont des profils de gagneurs, des types durs qui veulent gagner de l’argent. Ce ne sont pas toujours les plus sympathiques, mais il faut accepter qu’ils soient bien payés et ne pas hésiter à leur proposer un cadre favorable pour développer leurs activités. Aux États-Unis, Bill Gates, Steve Jobs sont des stars, eh bien ! n’hésitons pas à faire autant de louanges en France ou dans le monde arabe à nos meilleurs entrepreneurs. Au-delà, l’avenir passe par les entrepreneurs femmes qui seront un moteur incontournable. C’est d’ailleurs de ce point de vue l’une des révolutions majeures à opérer dans le monde arabe où les femmes ne travaillent pas.
Enfin pour revenir sur la question de l’accueil des étudiants étrangers que la CGE porte haut dans ses prises de position, j’en partage totalement les finalités. C’est capital pour l’avenir de l’Europe et pour celui de la France, car négliger ou repousser ces étudiants les conduira inéluctablement vers d’autres destinations à notre détriment. La France possède cet atout d’être un pays d’immigration et les populations déjà présentes sur notre sol doivent nous permettre de créer des liens avec leur pays d’origine, donc de nouveaux marchés et de nouveaux échanges. Un pays qui se ferme est un pays qui meurt.
Il faut renforcer l’attractivité de notre pays et le modèle des grandes écoles doit servir de pilote pour une telle ambition. Notre pays a besoin d’être irrigué, il a besoin d’eau. L’eau, c’est les flux de la mondialisation. Ne nous reposons pas sur nos acquis : soyons attentifs à notre attractivité à chaque instant, ce sera notre seul itinéraire de progression, pour que les étudiants qui viennent choisir notre pays pour se former, deviennent demain nos ambassadeurs dans le monde.
Propos recueillis par Pierre Duval
CGE – Chargé de mission Communication