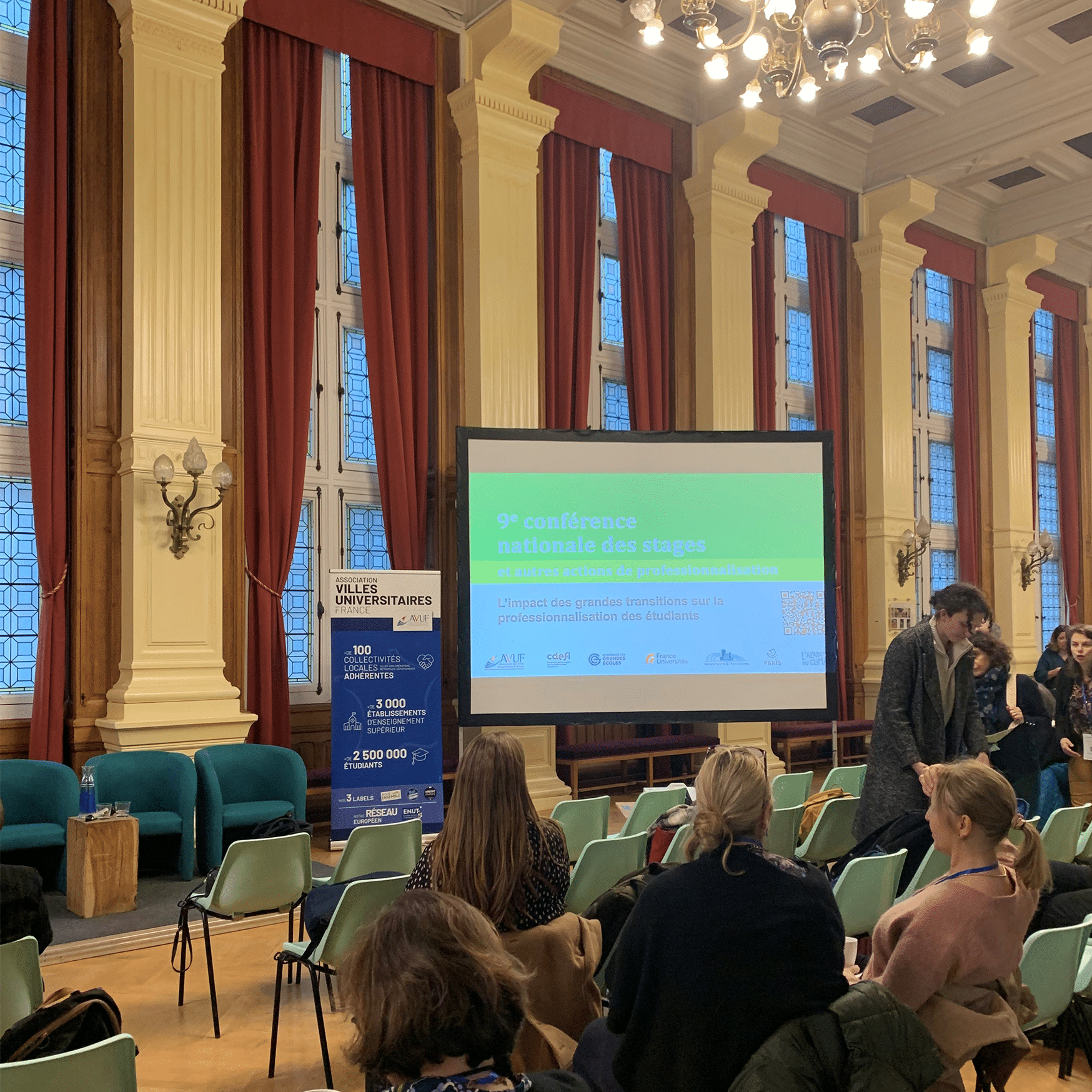Christian Lerminiaux, né le 22 juin 1957 à Paris, est directeur de l’Université de technologie de Troyes (UTT) depuis septembre 2004. Diplômé de l’École normale supérieure de Cachan, il est docteur en physique atomique. Président de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) depuis mai 2011, Christian Lerminiaux est également vice président d’ALLISTENE (Alliance des sciences et technologies du numérique) en charge de l’International et il est membre du conseil de surveillance du programme « Investissements d’Avenir ».
Avant sa nomination à la tête de l’UTT, Christian Lerminiaux a rempli des fonctions à responsabilités stratégiques en entreprise et dans des institutions de recherche. Il était directeur du programme Microsystèmes du CEA Leti à Grenoble de 2003 à 2004. De 1989 à 2003, il a occupé des postes stratégiques dans l’entreprise Corning, un leader mondial dans le domaine de la fibre optique. Il y était notamment directeur de la recherche dans le domaine des amplificateurs optiques et directeur de la technologie dans le secteur des technologies optiques et physiques de composants.
De 1983 à 1989, il enseignait en électronique, électrotechnique et automatisme à l’université de Paris 13. Il contribuait à la mise en place de la formation d’ingénieurs en télécommunications, tout en poursuivant ses recherches en spectroscopie non linéaire.
Expert pour la Commission européenne, Christian Lerminiaux est l’auteur de plus de 30 publications scientifiques et il détient 10 brevets. Distinctions : Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2009.
CGE : Depuis mai 2011, date de votre élection à la présidence de la CDEFI, quelles ont été les principales actions mises en œuvre pour valoriser les priorités de votre mandat, notamment en matière d’attractivité des formations d’ingénieurs « à la française » ?
C.L. : Il y en a eu beaucoup et nous les détaillerons tout à l’heure. Mais revenons à l’attractivité. Tout d’abord reconnaissons la chance que nous avons de vivre dans un pays dans lequel les meilleurs étudiants viennent dans nos formations. Beaucoup de nos établissements partenaires étrangers nous envient. Et de plus, depuis quelques années, le nombre de candidats souhaitant intégrer nos formations augmente de nouveau.
Plutôt donc que de vouloir à tout prix « normaliser » les formations d’ingénieur pour les intégrer dans un modèle LMD standardisé , il faut insister sur le modèle qu’elles représentent pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur français et notamment les universités.
Enfin ce modèle « à la française » est en train de conquérir le monde. Il nous faut simplement être conscients de la valeur en matière d’ingénierie pédagogique de ce modèle et trouver le bon moyen de l’exporter en en captant les justes retours. D’où d’ailleurs la mise en place d’un groupe de travail sur ce sujet.
CGE : Selon vous, quel est le meilleur moment et quels sont les meilleurs vecteurs pour valoriser les choix de formations d’ingénieurs chez les lycéens et les jeunes étudiants ? Et plus particulièrement vis-à-vis de la population féminine ?
C.L. : Si l’orientation en direction d’une école d’ingénieurs se fait au moment du lycée (première-terminale), c’est dès la quatrième et la troisième que l’orientation scientifique intervient. On peut le regretter, car c’est un modèle tubulaire qui offre peu de possibilités de réorientation.
Nous avons publié une étude, il y a deux ans, sur les motivations des jeunes pour intégrer une formation d’ingénieurs. Les résultats confirment ce que nous pressentions, à savoir la faillite du système d’orientation français. Quand on leur demande quel est le principal facteur d’influence ayant orienté leur choix vers une école d’ingénieurs, le conseiller d’orientation n’arrive qu’en 7ème position, très loin derrière le père et la mère, le professeur avec lequel ils ont un lien de confiance et qui les conseille. Cette situation encourage l’endogamie sociale puisque ce sont ceux qui ont la connaissance, les parents, qui la délivrent. Tant que le système d’orientation français ne sera pas réformé en profondeur l’ascension sociale ne fonctionnera plus.
Au niveau des filles, la tendance est encore plus prononcée puisque là c’est la mère qui joue un rôle déterminant. Si elle-même est ingénieure, sa fille aura une probabilité plus grande de s’orienter vers ce type de cursus.
Il me semble que sur ce sujet, on peut agir à plusieurs niveaux. L’orientation d’abord. Nous avons-nous-mêmes pris le sujet en main en créant un site d’information et d’orientation sur les écoles d’ingénieurs avec des témoignages, des conseils et une présentation des écoles. Nous allons mettre l’accent sur la promotion la plus large possible de ce site au cours de l’année qui vient. Mais là encore, gare aux idées reçues, il nous faut convaincre !
Deuxième action à conduire, la représentation « métiers » de l’ingénieur. On se rend compte aujourd’hui que nos formations sont prisées pour l’insertion professionnelle rapide et à haut niveau de rémunération qu’elles garantissent mais les métiers qu’elles proposent restent mal connus. Il est important de travailler à ce niveau car cela modifie la représentation sociale de l’ingénieur et peut être un facteur d’influence important, notamment auprès des jeunes filles.
CGE : Dans le développement des passerelles avec les entreprises, quelle place prend l’alternance ?
C.L. : Une place essentielle ! Mais d’ailleurs il en a toujours été ainsi pour les formations françaises d’ingénieurs. La structure même de notre offre de formation est basée sur l’alternance, ne serait-ce que la part importante accordée aux stages, qui est, en soi, la première forme d’alternance. Songez que si on ne regarde que les stages de fin d’études, les écoles françaises d’ingénieurs, à raison de 6 mois de stage en fin de cycle ingénieur, apportent quelques 180 000 personnes/ mois aux entreprises !
Je vois aujourd’hui plusieurs défis en matière d’alternance. Le premier est lié aux universités. La Loi LRU leur confie une mission d’insertion professionnelle à laquelle nous sommes déjà très sensibles dans nos formations mais qui représente un nouveau défi pour elles. En l’espace de 5 ans, elles ont déjà fait de nombreux progrès. L’alternance est l’un des leviers qu’elles devront actionner au cours des prochaines années.
Le second défi nous concerne tous, c’est celui de l’apprentissage. C’est un formidable vecteur de dynamisme économique, d’insertion professionnelle et d’ascension sociale. Mais c’est un sujet complexe à l’échelle de l’enseignement supérieur pour plusieurs raisons. La formation d’abord. Ces formations répondent aux mêmes exigences que la formation dite « traditionnelle », c’est-à-dire qu’elles doivent bénéficier de la même notoriété et être à même de délivrer les mêmes diplômes. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une formation partagée avec les entreprises et nous devons donc respecter les contraintes de celles-ci, notamment quand il s’agit de PME-PMI. Sur ce point, nous devons avoir un dialogue constructif avec la CTI pour proposer une offre de formation adaptée et plus souple. C’est ensuite une question de financement et à ce sujet, je crois qu’il faut être clair. On présente aujourd’hui l’apprentissage comme l’un des moyens de diversifier les ressources financières des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. C’est en partie vrai mais jusqu’où pourrons-nous aller ? Aujourd’hui une entreprise qui embauche un apprenti paye une partie de sa formation et le rémunère durant celle-ci. Augmenter nos flux d’apprentis signifie accentuer la contribution financière demandée aux entreprises. Jusqu’où sont-elles prêtes à s’engager sur ce point ? Les régions complètent le financement du dispositif. Là aussi, augmenter nos flux équivaut à accroître la part de leur financement. Jusqu’où les régions sont-elles prêtes à nous accompagner dans cette voie ? Pour toutes ces raisons, je crois que nous avons intérêt à développer l’apprentissage mais en ayant conscience de deux choses : il ne s’agit pas de la voie unique pour notre développement et l’apprentissage ne pourra pas se développer sans que les écoles soient davantage impliquées dans la gestion des CFA.
Enfin le troisième défi est celui de la formation continue. C’est l’alternance entre le monde professionnel et le monde de la formation. Le temps est venu de faire prendre conscience à nos diplômés que l’environnement professionnel dans lequel ils évoluent est en constante mutation. Cela requiert une grande flexibilité pour laquelle il est nécessaire de se former tout au long de sa vie. On ne peut plus vivre dans le mythe de la formation d’excellence qui se suffit à elle-même, du diplôme obtenu avant l’âge de 25 ans et qui vous garantit l’eldorado professionnel jusqu’à la retraite. On parle beaucoup aujourd’hui de la nécessité de réindustrialiser la France et d’accroître notre capacité d’innovation. Pour innover il faut être à la pointe de la découverte en permanence. La formation tout au long de la vie est cet outil qui doit nous permettre d’être dans une posture permanente d’innovation.
Ces deux derniers sujets – l’apprentissage et la formation continue – sont, de mon point de vue, essentiels pour les écoles d’ingénieurs qui forment les cadres de l’industrie française. C’est pourquoi nous avons créé deux groupes de travail chargés de réfléchir à l’évolution de ces deux types de formation dans nos établissements. Ils devront nous rendre leurs conclusions au cours du premier semestre 2012.
CGE : Les mécanismes de soutien à l’innovation s’intensifient par une « recherche » créative, active, pertinente et organisée. Comment projetez-vous l’articulation de cette vertu ; d’une part, dans les liens entre les établissements de formation et les principaux organismes de recherche ; d’autre part, dans l’équilibre nécessaire entre la connaissance scientifique, la recherche de compétences et les sciences humaines et sociales (SHS) ?
C.L. : Nous devons travailler à promouvoir une recherche qui fasse sens. La recherche française est de qualité mais là encore notre système souffre de son morcellement et de la cristallisation des intérêts entre les établissements d’enseignement supérieur (eux-mêmes divisés entre écoles et universités) et les organismes de recherche. L’approche par projets offre des perspectives intéressantes car elle nous oblige à ne pas raisonner d’abord en termes de structures mais avant tout à prendre conscience d’un intérêt partagé puis ensuite de ce que chacun peut apporter pour atteindre l’objectif commun. En cela, les « investissements d’avenir » sont utiles.
Mais il ne faut pas également oublier les entreprises et notamment les PME. Avoir une recherche qui fasse sens, c’est avoir une recherche qui réponde à des besoins de la société. Nous devons donc encourager les initiatives nous permettant de renforcer ce lien de nos établissements avec les entreprises. La réindustrialisation passe par là. Le crédit Impôt-recherche est un outil et il a fait ses preuves. Il doit y en avoir d’autres. De ce point de vue, le soutien à l’innovation c’est également être capable de former des docteurs compétents pour évoluer dans un environnement concurrentiel. Sur cela, la France accuse un retard important. Le doctorat n’est pas assez reconnu par nos entreprises car il n’est pas assez lisible pour elles. C’est un enjeu majeur car, dans la mesure où nous ne sommes pas en situation d’offrir aux entreprises les cadres dont elles ont besoin en matière de recherche, elles implantent leurs centres de R&D chez nos concurrents. C’est pour cela que nous proposons la mise en place d’une mention « Ingénierie pour l’entreprise » à destination du doctorat. Il s’agit d’appliquer les recettes qui ont fonctionné pour les formations d’ingénieurs et garantir aux entreprises un ensemble de compétences propres aux docteurs inscrits dans ce parcours et rendant leur diplôme lisible pour l’environnement concurrentiel.
Concernant l’équilibre entre connaissances scientifiques et sciences humaines et sociales, oui à la pluridisciplinarité. C’est d’ailleurs le cœur même de l’ingénierie et, au-delà, de toute démarche innovante. Les innovations naissent au carrefour des disciplines. Mais non à l’omnidisciplinarité. Or aujourd’hui, on a tendance à utiliser l’argument de la pluridisciplinarité pour inciter au regroupement de la totalité des formations existantes sur un même site. Là, encore, cherchons à « faire sens ». Réunissons des disciplines qui ont un intérêt à travailler en commun parce qu’elles partagent un projet. Dans le cas contraire, nous ne créerons que des juxtapositions disciplinaires sans communication entre elles.
CGE : Les enjeux de la représentativité de l’ingénierie française à l’international sont nombreux. Comment optimiser la compétitivité de nos établissements ? Quels types de structures manquent encore en France ? Quid des échanges ou de l’intégration d’étudiants étrangers dans nos promotions ? Quel avenir pour l’implantation de campus à l’étranger ?
C.L. : Nous devons travailler à la lisibilité de notre offre de formation et de nos activités de recherche. Le fait que la CTI soit rentrée dans un processus européen d’accréditation nous rend plus lisibles au plan européen.
J’attache une grande importance à notre compétitivité internationale. La CDEFI y est historiquement très sensible. Nous coordonnons déjà depuis plusieurs années avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère des Affaires étrangères les programmes FITEC avec nos principaux partenaires d’Amérique Latine. Nous lançons cette année un nouveau programme d’accueil d’élèves-ingénieurs colombiens dans nos écoles. Nous le voyons bien, notre offre de formation est compétitive au plan international. C’est le modèle d’exportation de notre offre qui est problématique.
Je crois que ce qui nous fait collectivement le plus défaut est notre absence de stratégie vers l’international. La France reste trop recroquevillée sur sa sphère d’influence historique héritée de ses anciennes colonies. Il ne faut plus maintenant avoir peur de s’ouvrir à d’autres marchés. Nous restons aujourd’hui dans une posture d’évangélisateur. La réalité du terrain est tout autre, nous évoluons dans un environnement global et hautement concurrentiel. Là aussi l’actualité illustre mon propos. Le débat que nous avons aujourd’hui à propos de l’employabilité en France de nos diplômés étrangers fait les « choux gras » de nos principaux concurrents. Dès lors que notre pays souffre d’une relative insuffisance de candidats d’excellence pour nos formations (insuffisance que nous combattons par ailleurs), nous sommes conduits à investir énormément dans la recherche de talents étrangers que nous formons, à la charge du contribuable principalement, afin d’assurer à nos entreprises la matière grise dont elles ont besoin. Il serait regrettable que la France ne cherche pas à rentabiliser cet investissement. Pour tout diplômé ingénieur étranger que nous n’embauchons pas en France, ce sont deux emplois de perdus : le sien, car il n’y a pas de diplômé français susceptible de prendre le poste non pourvu, et l’emploi induit qui en aurait résulté. C’est aussi le cadeau d’un ingénieur bien formé à nos pays voisins qui se chargent eux de fournir l’emploi que nous n’avons pas voulu pourvoir.
Il en va de même pour l’implantation de nos formations à l’étranger. On ne peut plus aujourd’hui s’implanter dans un pays, à sa demande, et le payer pour cette implantation. La réalité financière de nos établissements nous oblige à un peu plus de pragmatisme et de responsabilité de ce point de vue. Nous avons souhaité la mise en place d’un groupe de travail piloté par notre commission « International » qui sera chargé de conduire une réflexion sur les conditions d’exportation de nos formations à l’étranger. Il devrait rendre son rapport d’ici l’été.
L’attractivité internationale de nos établissements est un enjeu considérable. On voit bien la nécessité de s’organiser pour répondre à ce défi. Mais il faut que nous travaillions tous dans la même direction. Ce qui parfois reste compliqué. Accueillir des étudiants étrangers lève d’importants problèmes logistiques auxquels il faut apporter des réponses satisfaisantes : conditions d’hébergement, formation à la langue et à la culture française, accompagnement personnalisé le cas échéant… Nous sommes en train de nous doter d’un opérateur unique chargé de nous accompagner dans cette voie. Le moins que l’on puisse dire est que les établissements n’auront pas été étroitement associés à sa création. Il sera difficile de conduire cette politique sans prendre en compte les acteurs de cette attractivité que nous sommes. Nous verrons dès le début de l’année 2012 sur quelles bases cet opérateur entend travailler. Nous sommes à l’écoute.
CGE : Travailler sur les données pédagogiques et structurelles demande de l’engagement et du soutien financier, mais les moyens de l’État peuvent ne pas suffire. Quelles autres pistes envisagez-vous en ce sens et comment comptez-vous amorcer ces autres potentiels ?
C.L. : C’est un fait : les financements de l’Etat ne suffisent plus à soutenir le développement de nos établissements. Nous avons eu au cours des 5 dernières années un budget préservé pour au moins les établissements placés sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais cela reste un budget stagnant, peu à même de permettre un quelconque développement pour des formations qui ont le vent en poupe. Quant aux écoles relevant des ministères techniques, elles ont déjà vécu ce que connaîtrons l’ensemble de nos établissements au cours des prochains mois : une diminution de leur budget et de leur poste.
Je lie cette question à celle de la croissance économique de la France. Tout le monde s’accorde à dire que le retour à la croissance passera nécessairement par la réindustrialisation du pays. Toutes nos entreprises partenaires nous disent qu’elles auront besoin d’ingénieurs et nous estimons que pour répondre à la demande il faudra sans doute passer de 30 000 à 40 000 diplômés par an. Dès lors l’équation est simple à poser mais compliquée à résoudre : comment former dix mille ingénieurs de plus par an avec des contraintes financières plus lourdes ? Le problème est encore plus complexe si on le projette dans un environnement international. Aujourd’hui le coût moyen de la formation d’un ingénieur en France est de 12 000 euros par an contre 22 000 en Allemagne.
On le voit, il est nécessaire de poser la question de la diversification des ressources financières des écoles françaises d’ingénieurs et au-delà de l’ensemble de l’enseignement supérieur. Quelques pistes ont déjà été évoquées mais il ne faut pas être simpliste sur ce sujet. Il est totalement illusoire d’envisager combler notre besoin de financement en intervenant uniquement sur les droits d’inscriptions. On l’a vu plus haut, les entreprises et les anciens élèves devront aussi contribuer, et largement. Quant à l’Etat, il serait sans doute bon qu’il se dote d’un objectif à 10 ans en matière de diplômés formés, et qu’il réaligne les dotations aux établissements en fonction de ces objectifs.
Nous sommes en train de préparer des propositions sur ce sujet mais nous sommes convaincus qu’une remise à plat globale du système sera nécessaire et que la façon dont nous serons capables d’y répondre conditionnera là encore notre compétitivité de notre système par rapport à nos principaux partenaires. Le choix est simple : être marginalisés ou rester dans la course.